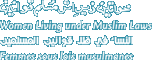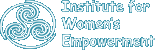Iraq: Une femme libérée - Giuliana Sgrena
Source:
Libération Giuliana Sgrena, 57 ans, Italienne. Journaliste du «Manifesto» et militante féministe. Otage un mois à Bagdad, elle n'est pas encore sortie du drame qui a ensanglanté sa délivrance.
Elle n'a pas encore défait les noeuds sur l'écharpe qui servaient à compter les jours. Mais elle ne guette plus les cinq appels du muezzin qui rythmaient le quotidien.
Giuliana Sgrena a recommencé à dormir, à jeter un oeil sur la presse, à embrasser ses proches. Elle a été otage à Bagdad, pendant un mois, du mystérieux groupe des Moudjahidin sans frontières. L'histoire de son enlèvement aurait dû s'arrêter là. Dans le cri de «victoire» lancé aux côtés de Nicola Calipari, l'agent des services secrets italiens, venu la récupérer, le 4 mars en fin d'après-midi, dans une rue de la capitale où ses ravisseurs venaient de l'abandonner. «Je ne me sens pas encore libre», glisse-t-elle, dans sa petite chambre de l'hôpital militaire romain du Celio.
La mort, dans ses bras, de «Nicola», son sauveur, tué par des tirs américains près de l'aéroport, a effacé l'euphorie de la libération. Des centaines de milliers d'Italiens avaient réclamé cet épilogue dans les rues de Rome deux semaines plus tôt, liant le sort de la journaliste du quotidien communiste Il Manifesto à l'affirmation de leur engagement pacifiste. Blessée à l'épaule, à proximité du poumon, par des éclats de balle, l'oeil gauche encore tuméfié, Giuliana Sgrena résume d'une voix incertaine : «Je suis contente mais pas heureuse. La fusillade, la conclusion tragique et les polémiques (guet-apens ou accident, ndlr) qui ont suivi m'ont empêché d'analyser à fond ma séquestration.»
De l'Algérie à l'Afghanistan, du Proche-Orient à l'Irak, elle a traîné, malgré sa frêle silhouette, une réputation de journaliste «dure», «ferme». «Une teigneuse», avancent certains collègues. «Il est difficile de la faire changer d'opinion, elle est peu influençable, ce n'est pas une femme à l'émotion facile, décrit l'ancienne parlementaire et fondatrice du Manifesto, Luciana Castellina. Elle est réservée mais déterminée comme les montagnards de sa région d'origine. C'est le contraire d'une Napolitaine extravertie.»
«Elle est devenue fragile», constatent aujourd'hui les amies proches. Sur son septième voyage en Irak, elle dit : «A mon âge (57 ans), je n'aurais peut-être pas dû oser.» Et sur son reportage sur les réfugiés de Fallouja dans une mosquée près de l'université de Bagdad, où elle a été enlevée, elle ajoute : «J'y suis restée quatre heures. J'aurais peut-être dû partir avant. Mais l'imam m'a demandé d'attendre la fin du sermon. Je n'ai pas voulu manquer de courtoisie.» Passé la crainte d'avoir été enlevée par des terroristes islamistes, Giuliana Sgrena organise sa réclusion pour résister. «Je devais sauver ma dignité.» Après avoir glissé son pouce en travers du cou, un de ses ravisseurs lui fait comprendre qu'elle n'est pas dans les mains de «coupeurs de têtes». Les Moudjahidin sans frontières lui permettent de voir subrepticement, sur Euronews, sa photo géante sur la place du Capitole, à Rome, et la première manifestation de soutien. «Si je tenais intérieurement, j'étais convaincue que les autres feraient tout pour me sauver.» Alors, du fond de sa pièce à la fenêtre calfeutrée, munie d'un simple lit, «sans livres, sans crayons, sans miroir, sans rien», la journaliste trouve des «escamotages». Elle pense à Nelson Mandela, «vingt-sept ans en prison». A son père de 90 ans, ancien cheminot, qui fut résistant communiste dans le Piémont, qui lui a légué la passion politique. Elle, qui n'a pas d'enfants, s'imagine raconter son existence à sa nièce. S'astreint à une demi-heure de gymnastique par jour. S'inquiète lorsque le bruit des hélicoptères américains laisse planer l'hypothèse d'un blitz pour la libérer. Elle en est persuadée : «Mes ravisseurs m'auraient alors immédiatement exécutée.»
Giuliana Sgrena croise ses geôliers lorsqu'on lui permet de quitter la pièce pour se rendre aux toilettes. Ou pour se laver, «tous les trois ou quatre jours». De temps en temps, elle les entend réciter le Coran. Le soir, on lui apporte des fruits. Parfois s'engage alors une conversation avec l'un d'eux. Giuliana Sgrena ne cesse de leur répéter : «Cela n'a pas de sens de m'avoir enlevée.» Elle va jusqu'à s'énerver : «Je suis contre l'intervention américaine, contre l'occupation!» Invariablement, elle s'entend répondre : «C'est la guerre, nous devons exploiter tous les moyens à notre disposition.» Puis, un jour, on lui demande d'«écrire une lettre avec les noms des membres de [sa] famille». Signe que des négociations ont démarré, cela lui permet d'endurer le froid et les coupures d'électricité. Elle explique : «Mon enlèvement n'est que la confirmation brutale de la dégénération produite par la guerre et l'occupation.» Le ton est redevenu vif : «La seule solution, c'est le retrait des troupes d'Irak.»
Pacifiste, Giuliana Sgrena l'a toujours été. C'est à travers la mobilisation contre l'implantation des missiles Cruise américains en Europe, dans les années 80, qu'elle se rapproche du Manifesto, le quotidien fondé en 1971 par des intellectuels communistes en rupture avec la ligne du PCI. A l'université de Milan, où elle a étudié plusieurs langues, elle a adhéré «un peu par hasard» au «mouvement étudiant» dans l'effervescence post-68, puis glissé dans les petites formations d'extrême gauche, où elle rencontre son compagnon Pier Scolari, graphiste. «J'ai été imprégnée des idées communistes de mon père mais le PCI nous apparaissait trop rigide.» Elle collabore à la revue Paix et Guerre, où elle croise Paolo Gentiloni, aujourd'hui député du centre gauche. «C'était une jeune femme très ferme, excessivement sérieuse, se souvient ce dernier. Aujourd'hui, elle dirait que je suis devenu de droite. Elle est restée sur ses positions.»
Giuliana Sgrena n'a rien d'une Pasionaria. Ni d'une fonctionnaire de parti. En 1984, elle se retrouve sans travail et transfère définitivement son militantisme dans le journalisme, au Manifesto. «Je ne peux distinguer mon engagement politique de mon travail journalistique», dit-elle encore aujourd'hui. Son quotidien tire à 40 000 exemplaires et la rémunère 1350 euros mensuels. Elle abhorre l'étiquette «correspondant de guerre», mais n'a cessé depuis près de vingt ans de couvrir des conflits. «La seule chose qui m'intéresse, dit-elle, c'est de raconter leurs effets sur les populations civiles.» En Algérie, comme plus tard en Afghanistan, cette farouche féministe a dénoncé les violences faites aux femmes, s'opposant au voile islamique. Au Manifesto, certains l'accusent d'avoir rejoint «la gauche bien-pensante». «Elle a fini par mettre sur le même plan les Américains et les islamistes, oubliant que c'est l'impérialisme qui produit le terrorisme», s'irrite un collègue. Giuliana Sgrena continuera à arpenter les zones de conflits. Mais pas en Irak. Elle a changé : «Je me suis rendu compte que j'avais toujours privilégié le travail et négligé les sentiments.»
mardi 22 mars 2005
La mort, dans ses bras, de «Nicola», son sauveur, tué par des tirs américains près de l'aéroport, a effacé l'euphorie de la libération. Des centaines de milliers d'Italiens avaient réclamé cet épilogue dans les rues de Rome deux semaines plus tôt, liant le sort de la journaliste du quotidien communiste Il Manifesto à l'affirmation de leur engagement pacifiste. Blessée à l'épaule, à proximité du poumon, par des éclats de balle, l'oeil gauche encore tuméfié, Giuliana Sgrena résume d'une voix incertaine : «Je suis contente mais pas heureuse. La fusillade, la conclusion tragique et les polémiques (guet-apens ou accident, ndlr) qui ont suivi m'ont empêché d'analyser à fond ma séquestration.»
De l'Algérie à l'Afghanistan, du Proche-Orient à l'Irak, elle a traîné, malgré sa frêle silhouette, une réputation de journaliste «dure», «ferme». «Une teigneuse», avancent certains collègues. «Il est difficile de la faire changer d'opinion, elle est peu influençable, ce n'est pas une femme à l'émotion facile, décrit l'ancienne parlementaire et fondatrice du Manifesto, Luciana Castellina. Elle est réservée mais déterminée comme les montagnards de sa région d'origine. C'est le contraire d'une Napolitaine extravertie.»
«Elle est devenue fragile», constatent aujourd'hui les amies proches. Sur son septième voyage en Irak, elle dit : «A mon âge (57 ans), je n'aurais peut-être pas dû oser.» Et sur son reportage sur les réfugiés de Fallouja dans une mosquée près de l'université de Bagdad, où elle a été enlevée, elle ajoute : «J'y suis restée quatre heures. J'aurais peut-être dû partir avant. Mais l'imam m'a demandé d'attendre la fin du sermon. Je n'ai pas voulu manquer de courtoisie.» Passé la crainte d'avoir été enlevée par des terroristes islamistes, Giuliana Sgrena organise sa réclusion pour résister. «Je devais sauver ma dignité.» Après avoir glissé son pouce en travers du cou, un de ses ravisseurs lui fait comprendre qu'elle n'est pas dans les mains de «coupeurs de têtes». Les Moudjahidin sans frontières lui permettent de voir subrepticement, sur Euronews, sa photo géante sur la place du Capitole, à Rome, et la première manifestation de soutien. «Si je tenais intérieurement, j'étais convaincue que les autres feraient tout pour me sauver.» Alors, du fond de sa pièce à la fenêtre calfeutrée, munie d'un simple lit, «sans livres, sans crayons, sans miroir, sans rien», la journaliste trouve des «escamotages». Elle pense à Nelson Mandela, «vingt-sept ans en prison». A son père de 90 ans, ancien cheminot, qui fut résistant communiste dans le Piémont, qui lui a légué la passion politique. Elle, qui n'a pas d'enfants, s'imagine raconter son existence à sa nièce. S'astreint à une demi-heure de gymnastique par jour. S'inquiète lorsque le bruit des hélicoptères américains laisse planer l'hypothèse d'un blitz pour la libérer. Elle en est persuadée : «Mes ravisseurs m'auraient alors immédiatement exécutée.»
Giuliana Sgrena croise ses geôliers lorsqu'on lui permet de quitter la pièce pour se rendre aux toilettes. Ou pour se laver, «tous les trois ou quatre jours». De temps en temps, elle les entend réciter le Coran. Le soir, on lui apporte des fruits. Parfois s'engage alors une conversation avec l'un d'eux. Giuliana Sgrena ne cesse de leur répéter : «Cela n'a pas de sens de m'avoir enlevée.» Elle va jusqu'à s'énerver : «Je suis contre l'intervention américaine, contre l'occupation!» Invariablement, elle s'entend répondre : «C'est la guerre, nous devons exploiter tous les moyens à notre disposition.» Puis, un jour, on lui demande d'«écrire une lettre avec les noms des membres de [sa] famille». Signe que des négociations ont démarré, cela lui permet d'endurer le froid et les coupures d'électricité. Elle explique : «Mon enlèvement n'est que la confirmation brutale de la dégénération produite par la guerre et l'occupation.» Le ton est redevenu vif : «La seule solution, c'est le retrait des troupes d'Irak.»
Pacifiste, Giuliana Sgrena l'a toujours été. C'est à travers la mobilisation contre l'implantation des missiles Cruise américains en Europe, dans les années 80, qu'elle se rapproche du Manifesto, le quotidien fondé en 1971 par des intellectuels communistes en rupture avec la ligne du PCI. A l'université de Milan, où elle a étudié plusieurs langues, elle a adhéré «un peu par hasard» au «mouvement étudiant» dans l'effervescence post-68, puis glissé dans les petites formations d'extrême gauche, où elle rencontre son compagnon Pier Scolari, graphiste. «J'ai été imprégnée des idées communistes de mon père mais le PCI nous apparaissait trop rigide.» Elle collabore à la revue Paix et Guerre, où elle croise Paolo Gentiloni, aujourd'hui député du centre gauche. «C'était une jeune femme très ferme, excessivement sérieuse, se souvient ce dernier. Aujourd'hui, elle dirait que je suis devenu de droite. Elle est restée sur ses positions.»
Giuliana Sgrena n'a rien d'une Pasionaria. Ni d'une fonctionnaire de parti. En 1984, elle se retrouve sans travail et transfère définitivement son militantisme dans le journalisme, au Manifesto. «Je ne peux distinguer mon engagement politique de mon travail journalistique», dit-elle encore aujourd'hui. Son quotidien tire à 40 000 exemplaires et la rémunère 1350 euros mensuels. Elle abhorre l'étiquette «correspondant de guerre», mais n'a cessé depuis près de vingt ans de couvrir des conflits. «La seule chose qui m'intéresse, dit-elle, c'est de raconter leurs effets sur les populations civiles.» En Algérie, comme plus tard en Afghanistan, cette farouche féministe a dénoncé les violences faites aux femmes, s'opposant au voile islamique. Au Manifesto, certains l'accusent d'avoir rejoint «la gauche bien-pensante». «Elle a fini par mettre sur le même plan les Américains et les islamistes, oubliant que c'est l'impérialisme qui produit le terrorisme», s'irrite un collègue. Giuliana Sgrena continuera à arpenter les zones de conflits. Mais pas en Irak. Elle a changé : «Je me suis rendu compte que j'avais toujours privilégié le travail et négligé les sentiments.»
mardi 22 mars 2005