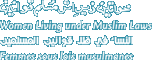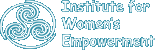Dossier 9-10: Créativité et critique
Date:
décembre 1991 | Attachment | Size |
|---|---|
| Word Document | 106.46 KB |
doss9-10/f
number of pages:
232 JB : Il est très difficile à un auteur de répondre à la question de savoir d'où lui vient une certaine histoire. Il est possible que parmi les milliers d'histoires qui sont dans l’air ça et là, une en particulier décide de venir à moi totalement de son propre chef. Je peux alors en être l'entière propriétaire, mais la question de savoir d'où elle a pu me venir devient, également pour moi, un mystère. Parfois, cependant, il arrive que l'on trouve non une histoire entière mais peut être juste une petite partie d'un événement réel. Pour «Main», je pense que je peux lier cette histoire à quelque chose qui m'est arrivé il y a des années. Je me souviens d'une parente qui nous rendait visite et qui avait fait à ma mère une remarque désinvolte à propos de l'enfant âgé d'un an et demi qui jouait là. Elle avait déclaré que cet enfant ne pouvait pas être le sien car il ne lui ressemblait en rien. J'ai été touchée par la réaction de l'enfant qui a poussé des hurlements et des cris de protestation et qui voulait que ces mots soient retirés. Cette incident a déclenché un enchaînement d'idées dans mon esprit. Je me suis dit : «Si une mère prétend que son enfant n'est pas le sien, quel effet cela peut-il avoir sur le psychisme de cet enfant ?».Ceci peut provoquer une crise d'identité que l'enfant devra endurer toute sa vie. Parfois, quand elles sont en colère, les mères peuvent tenir des propos qui peuvent susciter, chez un enfant, un sentiment d'insécurité permanent.
Il arrive également que dans une certaine situation, l'on se sente très mal à l'aise et que l'on ait le sentiment étrange de ne pas être à sa place dans un endroit où l'on a peut-être passé toute sa vie. Tout est si négatif et si irréel. A quoi peut-on attribuer cette expérience ? Je pense que cette sensation vient de ce qu'on est, en fait, en train d'essayer de se situer soi-même.
SK : La beauté de ce récit vient du fait qu'un concept abstrait très large a acquis une forme et un contexte spécifiques. Qualifier cette expérience de «moderne» ne signifie pas que dans le passé, les gens n'ont pas vécu cette sorte de réalité. Mais je pense que cette sensibilité a acquis une forme bien définie dans l'écriture «moderniste» mise en évidence d'abord en Occident au début de ce siècle. La crise de la culture liée au scepticisme et au cynisme à la suite de la Première Guerre Mondiale a suscité un certain nombre de questions philosophiques fondamentales concernant l'existence humaine.
Dans le roman urdu, j'ai noté que ce phénomène semble se produire non au début du 20ème siècle, mais à la fin des années 1950 et 1960. C'est à ce moment là que la sensibilité moderniste transparaît dans le nouveau roman. Je pense que cette sensibilité reflète en partie l'impact de la pensée occidentale sur l'écrivain indien, mais aussi, la possibilité que la partition du pays ait créé un génie du peuple, peut-être comparable à la situation d'après-guerre en Europe. Mais quoiqu'il en soit, malgré l'apparition de la nouvelle sensibilité, on ne perçoit généralement pas la préoccupation de l'écrivain indien pour de nouvelles formes d'expression. Le maintien des formes anciennes montre peut-être un désir conservateur de l'écrivain de maintenir la tradition. Avez-vous jamais éprouvé le besoin de briser les formes conventionnelles ?
JB : Je n'ai aucun problème avec les formes existantes. Comme vous l'avez dit, il y avait en Europe une grande activité philosophique et culturelle au début du 20ème siècle et on peut aisément en voir l'influence dans la littérature urdu. Nous avons en effet beaucoup appris de l'Occident. Mais je ne dirais pas qu'il y avait une absence quelconque d'expérimentation en urdu. Et je ne pense pas que l'évolution de notre littérature soit totalement due à ce qui s'est passé en Occident. Nous avons toujours eu notre propre base philosophique et nous avons notre propre style d'expression littéraire.
En ce qui concerne les influences sur ma propre écriture, j'en discute souvent avec mon époux Anwar, un érudit, qui me demande de lire tous les bons romans qui lui tombent entre les mains. J'ai souvent des réticences à lire les romans d'autres écrivains, surtout lorsque je suis moi-même en train d'écrire. Ceci perturbe mon état d'esprit ; le monde du roman que je peux être en train de lire influe sur le monde que je suis en train de créer. Je considère qu'il est très important de préserver l'authenticité de l'univers et des personnages que je suis en train de créer, et je pense qu'aucun écrivain n'aime l'idée de voir d'autres univers s'imposer sur sa propre création. Si l'oeuvre doit être originale et non imitative, nous avons intérêt à être en mesure de préserver le monde propre de notre oeuvre.
J'ai également fait beaucoup d'expérimentation. Il faut voir mes nouveaux récits. Je ne pense pas que l'on doive se conformer aux styles de nouvelles déjà existants. Je pense que toute nouvelle histoire vient avec son propre style. Le style dépend de la nature du contenu. Ma nouvelle «Ashtray main sulgata hua cigarette» [Cigarette brûlant dans le cendrier] relate l'histoire d'une femme ordinaire qui se consume par un bout, comme une cigarette, sans personne pour l'écouter, même pas son mari. Elle est une entité domestique qui s'occupe du foyer de son mari et satisfait le désir physique de celui-ci. Son mari est un grand fumeur et dans l'histoire, l'existence de la femme est identifiée à celle des cigarettes que l'homme fume et jette à volonté.
SK : Eh bien, ceci nous amène, je pense, à la question suivante que je souhaite vous poser. En tant que femme auteur, écrivant en urdu, dans une société plutôt conservatrice, quels genres de problèmes avez-vous rencontrés? Quelle conscience de soi s'est développée en vous en raison du fait d'être une femme ? Vous sentez-vous aliénée dans un monde masculin de l'écriture ? Etes-vous consciente d'avoir évité certains thèmes du fait que vous êtes une femme ?
JB : Franchement, je ne me suis jamais retenue d'aborder un thème particulier simplement parce que je suis une femme. Et je n'ai jamais considéré le fait d'être une femme comme un handicap. Je me suis toujours sentie libre d'exprimer tout ce qui me passionnait. Je ne me suis pas préoccupée de savoir comment la société pouvait réagir. Mais quand j'ai commencé à écrire, j'ai j'ai eu quelques déconvenues. Vous savez, je venais d'une famille très conservatrice appartenant à une société féodale de Badauin, surtout du côté de ma mère. Mon père était un érudit et un poète en arabe et en persan et était assez libéral pour souhaiter que ses filles se sentent libres. Par contre, ma mère était très orthodoxe et nous imposait beaucoup de restrictions. Elle se conformait au système du purdah et ne nous permettait d'aller nulle part sans escorte, ni de recevoir des visiteurs masculins. Mon père étant poète, un grand nombre de poètes nous rendaient visite. Je me souviens que je me demandais comment on pouvait créer une oeuvre originale. J'avais beaucoup de respect pour les poètes : Josh, Jigar, Sagar Nizami, Shakeel Badauni, Qatil Shifai. Je les considérais comme des être exceptionnels qui venaient de pays étranges et lointains.
Quand j'ai commencé à écrire sérieusement et à envoyer mes manuscrits aux éditeurs, je me suis heurtée à une forte opposition de la part de ma mère. Elle pensait que personne ne m'épouserait car je commençais à correspondre avec des hommes dans le monde de l'édition. Je dois vraiment beaucoup à mon père qui m'a permis de continuer. Je me suis mariée très jeune, en fait immédiatement après avoir terminé le premier cycle de mes études secondaires. Mon père souhaitait me voir épouser une personne ayant des goûts littéraires qui ne s'opposerait pas à ma vocation d'écrivain. J'avais déjà publié un livre quand j'ai épousé Anwar, qui s'est intéressé à moi d'abord parce que j'écrivais. J'écris depuis pratiquement 26 ans et il a toujours été très coopératif et très compréhensif. Voilà pour le plan domestique.
Quant à l'aspect social du monde littéraire, je me suis toujours sérieusement plainte de la façon dont le monde littéraire urdu me néglige. J'ai souvent entendu le commentaire suivant quand j'étais jeune : «Oh ! bien que ce soit une femme, elle écrit bien». La façon dont on est classé dans une catégorie séparée des «femmes écrivains» est inacceptable.Tout comme lors de grandes manifestations dans notre société, il semble que, dans le monde littéraire également, un enclos spécial a été créé pour les femmes. De toutes façons, de par mon tempérament, je n'aime pas trop fréquenter les gens, surtout s'il s'agit d'autres écrivains. J'ai remarqué que lors de leurs soi-disant rencontres littéraires, on parle de tout sauf de littérature. Je ne suis pas à ma place dans de telles réunions, et c'est peut-être pour cette raison que mon nom n'est pas inclus quand on passe en revue les auteurs pour décerner les prix littéraires. Il y a beaucoup de politique dans tout cela et je reste en dehors.
SK : La critique féministe est une prise de position très répandue qui s'est développée dans l'examen contemporain des oeuvres littéraires en Occident. On part de la perspective de la femme pour comprendre les personnages masculins et féminins d'une oeuvre littéraire ainsi que les mécanismes de la perspective de l'auteur. Pensez-vous que par une telle approche, on ne fera que remplacer un parti-pris par un autre, ou pensez-vous qu'une telle prise de position est nécessaire ?
JB : Il est évident qu'une telle réaction est nécessaire. Je ne pense pas que nous ayons, dans notre critique, quelqu'un qui travaille dans cette direction. J'aurais souhaité que ce fut le cas. Je pense qu'il est nécessaire d'examiner les écrits des femmes différemment. Je ne suis pas d'avis que la femme et l'homme perçoivent les expériences de la même façon. Il y a une différence et nous devons nous rendre à l'évidence et donner à chacun la place qui lui est due. Dans notre littérature, nos arts, etc. il y a une perspective distinctement féminine qui est projetée. On aurait tort de ne pas reconnaître ce fait ou de l'ignorer.
SK : Mais alors il y a, dirais-je, un autre niveau d'existence que l'on pourrait qualifier d'androgyne. Il y a peut-être un moment, dans le processus de création, où l'on transcende sa conscience d'être une femme ou un homme et où l'artiste doit en effet s'identifier au sexe du personnage qu'il ou qu'elle est en train de dépeindre. La conscience que l'on a d'appartenir à un genre n'exercerait-elle pas une influence et les préjugés sexuels ne pourraient-ils limiter la portée de la vision globale ?
JB : Le fait est que, en poésie comme dans le roman, les sentiments d'une femme apparaissent distinctement différents de ceux d'un homme, et même le mode d'expression en devient différent.
SK : Quand on présente un personnage, c'est vrai, la femme en tant que femme et l'homme en tant qu'homme doivent être dépeints tels qu'ils sont, mais je pense que, en tant que créateur de ces personnages, l'auteur doit peut-être transcender les limites de son propre genre pour être en mesure de s'identifier avec le personnage de sexe opposé. La critique féministe, à mon avis, ne tient pas compte de cela. Mais peut-être qu'il faut accorder une place spéciale à la femme écrivain dans la littérature urdu, ne serait-ce que pour compenser le peu de cas que l'on fait d'elle.
JB : En urdu, je crains qu'il n'y ait pas de bonne critique. On ne peut malheureusement vraiment pas parler de prises de position critiques convaincantes.
SK : Diriez-vous qu'il y a eu «des progrès» en littérature ? Avec des disciplines plus spécialisées dans le cadre des connaissances dont dispose l'humanité, avons-nous un meilleure emprise sur notre existence, et si oui, cela se projette-t-il dans l'art ?
JB : Non, je ne pense pas qu'il y ait eu de «progrès» en littérature. La nouvelle moderne en urdu a acquis un caractère assez particulier au nom de la «modernité». L'histoire a perdu son «caractère d'histoire», s'est enfermée dans un monde étrange et insulaire et les lecteurs ne pouvaient pas la comprendre. C'est différent si j'écris une histoire et que je la garde pour moi-même, mais si j'écris et que je demande à un autre de lire ce que j'écris, il faut alors établir la communication. L'histoire se passe entre vous, le lecteur, et moi, l'auteur. Ce n'est pas parce que vous la lisez que vous allez nécessairement l'aimer. Mais si une partie de l'histoire est restée en vous, alors l'histoire a également un sens pour moi. Si vous n'en gardez aucune partie, et si vous me la restituez toute entière, alors cette histoire est pour moi également dénuée de sens. Si l'histoire n'a pas la capacité de toucher quelqu'un, alors elle n'a pas de raison d'exister. Il est important qu'une histoire possède le «caractère d'histoire». Le fait de la narrer devrait retenir l'attention et devrait être captivant.
SK : Quand vous lisez d'autres écrivains, avez-vous jamais eu le sentiment que vous souhaitiez pouvoir écrire comme l'un d'entre eux ? Y-a-t-il eu des écrivains de l'influence desquels vous auriez aimé vous débarrasser ?
JB : Camus m'impressionnait énormément. Et j'ai lu Gorky quand j'étais assez jeune. J'ai été très émue par son roman «La Mère». Tchekhov, également m'a fait une forte impression mais je n'ai jamais senti que je devais écrire ou être comme l’un de ces auteurs. Vous savez, il m'arrive d'être si étroitement impliquée dans mes histoires que c'est presque comme si j'étais prise dans un piège. Même la nuit, je suis hantée et quand je me consacre le matin à mes tâches ménagères, le monde de mes récits jette une ombre lourde sur tout et je ne souhaite que l'isolement absolu. Quand j'écrivais mon récit «Cultural Academy», vous savez, j'ai rencontré le personnage Usha dans un rêve, lors d'une réunion au cours de laquelle elle m'avait été présentée. Elle ne m'a pas remarquée. Le matin, croyez-moi, c'était une expérience étrange d'avoir affaire à elle dans mon travail d’écriture après l'avoir vue en rêve. SK : Parfois peut-être, le monde du roman est plus réel que le monde dans lequel on doit réellement évoluer.
JB : Quand je suis plongée dans une histoire, je suis très mécanique dans mon monde «réel». Lorsque je suis totalement submergée et que je suis sous tension, je vais dans la cuisine et je fais des choses qui n'ont rien à voir avec mon récit. Quant à savoir ce qui est «réel», c'est mon récit lui-même qui doit me le dire. Je n'écoute aucune autre voix. Quand j'écrivais mon dernier roman «Bonded Labour», j'avais pensé décrire Salim d'une certaine façon, mais après en avoir écrit une partie, je me suis rendu compte que le personnage avait acquis une coloration différente. Le personnage souhaitait être différent de la façon dont je l'avais conçu. Généralement, quand un tel conflit se présente, je cède.
SK : Merci de nous avoir rendu accessible la réalité de votre monde imaginaire.
Sukrita Paul Kumar est écrivain et professeur d'Anglais à Zabir Hussein College à Delhi.
Reproduit de: Committee on South Asian Women (COSAW) Bulletin
Dpt. of Psychology, Texas A & M University, College Station, TX77843, U.S.A. - Vol. 7 (1-2), pp. 18-22, ISSN 0885-4319.