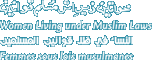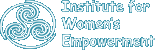Moyen-Orient: Entretien avec Farouk Mardam Bey
HD: Comment jugez-vous la création littéraire arabe contemporaine ?
Farouk Mardam Bey: Paradoxalement, elle n’a jamais été aussi florissante. La majorité des régimes ont voulu cadenasser les écrivains, lesquels ont finalement répliqué par l’audace et l’innovation. Ce qui est plutôt encourageant, tous les pays arabes étant confrontés aux mêmes spectres de la dictature et de l’intégrisme religieux. En outre, il s’est créé un champ culturel unifié, dans lequel s’expriment tous les écrivains aujourd’hui, qu’ils soient algériens ou soudanais, égyptiens ou libanais. La langue arabe littéraire est, grâce à eux, en pleine évolution. Beaucoup de jeunes auteurs émergent, flirtant plus du côté du récit intimiste, en rupture avec les romanciers des années 1960-1970, plus engagés politiquement.
HD: Ces nouveaux auteurs parviennent-ils à trouver des lecteurs ? Qu’en est-il de l’édition et des réseaux de distribution dans la majorité des pays arabes ?
F. M. B. La vie culturelle n’échappe pas aux crises politique et sociale qui touchent l’ensemble du monde arabe. Le marché du livre est en crise, ainsi que les réseaux de librairies. On lisait davantage dans les années 1960, période où Le Caire et Beyrouth étaient de véritables carrefours des cultures. Ce sont les ouvrages religieux qui dominent incontestablement, qui brodent toujours sur les mêmes thèmes, sur le mode apologétique. Ce qui illustre d’ailleurs un blocage de la pensée religieuse, même si certains intellectuels tentent de bousculer tout cela en insistant sur la nécessaire séparation de la religion et de l’État. Enfin, la plus profonde mutation est la circulation des auteurs et de leurs oeuvres dans l’ensemble des pays arabes, ce qui permet de contourner la censure. C’est ce qui amplifie encore le phénomène assez récent de best-sellers.
HD: Vous évoquiez l’interaction des cultures. Quelle influence a eu la mondialisation et les migrations sur la littérature arabe ?
F. M. B. Les littératures occidentales ont eu depuis longtemps une influence incontestable. Par exemple, la révolution poétique irakienne au début des années 1950 a été très marquée par les modèles européens. Les communistes lisaient Nazim Hikmet, Aragon ou Maïakovski, les autres Eliot. Ces auteurs ont été traduits en arabe, tout comme les grands romans russes classiques ou la littérature américaine. Dans les années 1950 et 1960, Nasser a encouragé la traduction d’oeuvres dramatiques avec deux collections subventionnées par l’État. Le prix modique de ces livres a permis la découverte de grands auteurs, de Tchekhov à Ionesco. On constate d’ailleurs une grande influence de Brecht sur nombre d’auteurs arabes de cette époque. Cette ouverture allait parfois trop loin chez certains, qui se sont coupés d’un patrimoine littéraire pourtant très riche. Les meilleurs sont ceux qui ont réussi à s’inspirer aussi bien de ce patrimoine que de la modernité occidentale.
HD: Vous pensez que c’est le cas pour certains des romanciers de la nouvelle génération ?
F. M. B. On constate chez beaucoup de ces romanciers une rupture totale avec la littérature politique qui a longtemps dominé. Après la guerre des Six-Jours et la défaite de 1967, le traumatisme des pays arabes a profondément marqué les intellectuels. Certains ont procédé à une critique féroce de leur société, d’autres se sont réfugiés dans une introspection inédite. Cela s’est traduit quelques années plus tard par la multiplication de romans intimistes, très axés sur la psychologie individuelle, ces « sales petites histoires », comme l’écrivait Deleuze. Et même si c’est un genre littéraire que je n’apprécie pas énormément, il a eu une grande importance dans les pays arabes, surtout quand les femmes se sont imposées. C’est l’un des traits les plus importants de la littérature d’aujourd’hui. Les femmes écrivent partout, y compris dans les pays du Golfe. Elles commencent à peser dans l’édition, portées par des phénomènes intéressants comme la publication du livre de Rajaa Alsanea, « les Filles de Ryiad », devenu un best-seller en Arabie saoudite. On pourrait penser qu’avec les systèmes politiques despotiques et la prégnance de l’islamisme radical les créateurs se taisent. Mais c’est le contraire. La création est véritablement devenue un acte de résistance.
HD: Ces dernières années, des écrivains ont été emprisonnés, poursuivis et même assassinés. Comment analysez-vous cette chasse aux sorcières qui touche les intellectuels arabes ?
F. M. B. La censure dans le monde arabe arbore différents visages. Dans certains pays, comme en Syrie ou en Tunisie, il existe une censure préalable où, avant de publier un livre, l’éditeur est obligé de déposer le manuscrit au ministère de l’Information qui donne ou non son autorisation. Ailleurs, elle se fait d’une manière plus perverse comme en Égypte où l’on peut écrire ce qu’on veut mais, une fois que le livre est en librairie, on déclenche une campagne contre l’auteur et les autorités interviennent. Quiconque peut intenter un procès au nom de la défense de l’islam. C’est ce que j’appelle la censure sociale car n’importe qui peut finalement interdire un livre. C’est ce qui est arrivé à Nasr Abou Zeid qui avait tout simplement réalisé une étude sémiologique du Coran. Il a été condamné comme apostat. Craignant à juste titre d’être assassiné, il a dû fuir l’Égypte. Dans l’ensemble, les auteurs sont devenus plus audacieux et plus libres. Ils ne pratiquent plus l’autocensure et osent enfin aborder ce fameux « triangle de l’interdit », à savoir la politique, la religion et la sexualité.
HD: Pensez-vous que la vitalité de cette création culturelle peut jouer un rôle pour sortir de l’impasse politique dans laquelle se trouvent une majorité de pays arabes ?
F. M. B.M Ce sont les écrivains et les artistes qui portent aujourd’hui le combat contre les dictatures et les intégrismes. Il existe des symboles forts de résistance. Je pense à l’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim à qui l’État avait voulu remettre le grand prix du roman. Alors que cet auteur vit vraiment modestement de sa plume, il a choisi de se rendre à la remise du prix pour expliquer son refus en dénonçant le régime de Moubarak, renonçant dans le même temps à une somme d’argent considérable. Cet acte courageux a eu un retentissement extraordinaire dans le monde arabe. Cela redonne un peu d’espoir. Car en l’état actuel des choses, le tableau est très noir. L’enjeu éducatif et culturel est déterminant.
HD: Qu’en est-il de la réception de la littérature arabe en France ?
F. M. B. La traduction de la littérature arabe a vraiment débuté dans les années 1970. Les phénomènes politiques ont eu une grande influence sur l’édition française. Par exemple, Mahmoud Darwich est publié pour la première fois en France en 1970, en écho à la résistance palestinienne. La traduction d’oeuvres d’écrivains arabes était à l’époque plus souvent motivée par la solidarité politique que par un strict intérêt littéraire. Ce n’est plus le cas de nos jours. Mais, comme pour l’ensemble de la production littéraire, le roman arabe est victime en France de la surproduction éditoriale. D’autres questions se posent sur la réception proprement dite des lecteurs français. Je pense que le public français a plus de mal à s’intéresser à des ouvrages littéraires arabes calqués sur la littérature française ou occidentale. Il cherche un minimum d’originalité, sans tomber dans l’exotisme à bon marché.
Entretien réalisé par Maud Vergnol: mvergnol@humadimanche.fr
(1) Farouk Mardam Bey a publié plusieurs ouvrages d’histoire politique. Il est l’auteur d’une « Anthologie de poésie arabe contemporaine », d’« Être arabe », de « Droit au retour » et du « Traité du pois chiche », tous publiés chez Actes Sud.
Humanité dimanche du le 3 juillet 2008