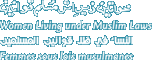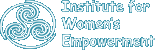Dossier 27: Le droit musulman de la famille en Israël : le rôle de l’État et la citoyenneté des femmes palestiniennes
Les questions de droit personnel revêtent une importance et un caractère décisif tout particuliers dès qu’il s’agit d’égalité des sexes, car ce droit recèle un modèle distinct de relations hommes-femmes. Essentiellement axé autour des rapports entre les sexes, le droit personnel musulman est devenu, dans nombre de situations (pays musulmans et communautés minoritaires/immigrantes, par exemple), le « symbole préférentiel » de l’identité musulmane [1] et se trouve désormais étroitement corrélé avec les différences religieuses/nationales.
Vu qu’il couvre un domaine perçu comme très délicat, toute tentative de réforme se heurte fréquemment à un rejet. En outre, le droit personnel établit la citoyenneté des femmes au sein de l’État, par l’entremise des communautés religieuses devenues les protectrices des affaires familiales. [2] Par conséquent, sonder le droit personnel permet d’explorer le rôle de l’État comme de la communauté dans la conception de la citoyenneté des femmes.
Nous examinerons, dans le présent document, le droit musulman de la famille en Israël en vue d’étudier la citoyenneté des femmes palestiniennes. Nous analyserons la conception juridique d’un certain type de citoyenneté sexuée et la capacité qu’a la loi d’influer sur l’intégration des femmes dans la communauté palestinienne. Ce faisant, nous nous intéresserons en particulier au rôle de l’État dans la conception de la citoyenneté des femmes palestiniennes.
Ce document se concentre sur le droit musulman de la famille en Israël bien que la minorité palestinienne d’Israël s’articule en trois groupes religieux : musulman (76 %), chrétien (15 %) et druze (9 %). Il serait, en effet, difficile de couvrir un éventail de questions s’étendant aux droits de la famille chrétien et druze dans le cadre d’une étude aussi brève.
Les citoyens palestiniens d’Israël
Les citoyens palestiniens d’Israël sont les personnes qui n’ont pas quitté leur terre natale après qu’elle soit devenue l’État d’Israël suite à la guerre de 1948. Ils représentent près de 20 % (1 million) de la population du pays et appartiennent aux communautés religieuses musulmane, chrétienne et druze. Sur le plan national et historique, ils font partie de la population palestinienne qui vit actuellement en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et en diaspora. [3]
La guerre de 1948 a détruit l’infrastructure sociale, politique et économique de la société palestinienne. Après la guerre et l’instauration de l’État d’Israël, les Palestiniens qui sont restés dans leur pays ont, de fait, cessé de constituer une population majoritaire et sont devenus une minorité ethnique et nationale dans un État exclusivement juif. Ils se sont retrouvés, selon les propres termes de Bishara, « en marge de la société israélienne. Ils sont devenus les citoyens d’un État dont ils n’ont pas choisi de faire partie et qui n’a pas été instauré pour eux. » [4] Leurs dirigeants comme leurs classes libérales, bourgeoises et moyennes se sont vus refuser le droit de retour et ont été contraints de vivre hors d’Israël, ce qui s’est traduit par une faiblesse politique et économique. [5]
Israël n’a jamais cherché à intégrer ses citoyens palestiniens, les traitant comme des citoyens de seconde zone, les excluant d’une citoyenneté israélienne pleine et entière et leur infligeant une discrimination systématique dans tous les domaines. Les gouvernements israéliens successifs, comme l’affirme Bishara, ont maintenu la communauté sous un contrôle étroit. Ils ont régulé leurs rapports avec la communauté dans le cadre de structures traditionnelles de médiation et ont tenté d’étouffer l’identité palestinienne et de diviser la communauté en son sein. Ces gouvernements les ont réduit au statut de « minorités religieuses » (musulmane, druze ou chrétienne) ou « non-juives » au lieu de les traiter en minorité nationale.
Israël n’a jamais eu pour vocation de représenter sa société civile, la population qui réside sur son territoire ou même l’ensemble de ses citoyens. Il s’agit de l’État du peuple juif, où que ses membres se trouvent. La législation israélienne sur la citoyenneté repose non pas sur le principe du jus soli (droit du sol), mais sur celui du jus sanguinis (liens du sang). Cette hiérarchie est le reflet de l’idéologie de l’État, telle qu’exprimée dans la déclaration d’indépendance et la loi sur le retour de 1950. Selon la loi sur le retour, tous les Juifs, d’où qu’ils viennent, ont automatiquement droit à la citoyenneté israélienne. Ce privilège est accordé uniquement aux Juifs. [6]
Il n’existe aucune séparation entre l’État et la religion en Israël, ce qui apparaît explicitement dans l’intégration partielle de la législation religieuse juive dans la législation nationale israélienne et le fait qu’être Juif donne droit à la citoyenneté israélienne automatique.
Le droit musulman de la famille en Israël : historique
En Israël, ce sont les « tribunaux religieux » qui jugent, selon la « loi religieuse », les affaires de statut personnel (mariage, divorce, pension alimentaire et garde des enfants). Si pour certaines, les citoyens ont le droit de s’adresser à un tribunal des affaires familiales de l’État, le mariage et le divorce demeurent de la compétence exclusive des « tribunaux religieux ».
Conformément à l’article 51-a du mandat britannique de 1922, qui reste applicable de nos jours, toutes les communautés religieuses reconnues en Israël disposent de leurs propres cours de justice religieuses : rabbiniques pour les citoyens juifs et musulmanes, chrétiennes et druzes pour les citoyens arabes. L’appartenance religieuse d’un individu détermine le tribunal religieux compétent pour statuer sur les questions de statut personnel et de la famille le concernant. [7]
Dans certains cas, les juifs, les chrétiens et les druzes peuvent choisir de porter leur différend devant les nouveaux « tribunaux des affaires familiales » de l’État, dans la mesure où il ne s’agit pas purement d’une affaire de mariage et de divorce. [8] Cependant, jusqu’en novembre 2001, les musulmans ne disposaient pas de ce choix, car les tribunaux religieux musulmans (désignés sous le nom de tribunaux de la Charia) conservaient la compétence exclusive en matière de statut personnel. De même, les chrétiens n’avaient pas la possibilité de choisir entre les tribunaux civils et religieux pour toute question d’obligation alimentaire envers la conjointe, puisque les tribunaux chrétiens possédaient une compétence exclusive dans ce domaine. Suite à une proposition de militantes palestiniennes, la Knesset (le parlement israélien) a adopté, au mois de novembre 2001, une loi investissant les nouveaux tribunaux étatiques des affaires familiales du pouvoir de juger les affaires de statut personnel des Arabes musulmans et chrétiens. Néanmoins, comme déjà mentionné, le mariage et le divorce continuent de relever de la compétence exclusive des cours de justice propres à chaque groupe religieux.
Les musulmans, jusqu’en novembre 2001, bénéficiaient d’une autorité judiciaire plus étendue que toute autre communauté religieuse du pays. Cette particularité résultait de l’article 51 du décret-loi Palestine Order in Council de 1922 qui les investissait d’une compétence exclusive en matière de droit personnel et de waqf (legs pieux). À la création de l’État d’Israël, cependant, leur organisation collective s’est complètement effondrée, les laissant orphelins des institutions collectives autonomes et du leadership religieux/politique dont ils disposaient à l’époque du mandat britannique. Les membres du conseil suprême musulman et les plus éminents spécialistes de la Charia, dont les muftis (juristes musulmans habilités à émettre des décrets religieux ou fatwas), les cadis (juges) et les principaux oulémas (savants), ont quitté le pays, ce qui a signifié la mort du système juridique religieux, de l’administration du waqf et des diverses institutions collectives. Dans ces circonstances, le bastion de la justice de la Charia en Israël s’est trouvé réduit à la juridiction religieuse en matière de droit personnel et de waqf. Il convient de noter que, sous la domination ottomane et sous le mandat britannique, la compétence des tribunaux de la Charia se limitait déjà aux questions de statut personnel, de succession et de waqf. Le droit pénal, les transactions civiles et les dommages corporels, entre autres questions, ont en revanche été transférées à la justice civile. [9]
En Israël, il existe sept tribunaux de première instance de la Charia, où siège un seul cadi, ainsi qu’une cour d’appel de la Charia constituée de deux ou trois cadis. Les juges de la Charia sont nommés, en conformité avec le droit civil, par les autorités civiles suivant les recommandations d’un comité présidé par le ministre des Affaires religieuses. [10] Les tribunaux de la Charia sont à dominance masculine en Israël. Tous les cadis sont des hommes. Bien que la loi sur la nomination des cadis de 1961 ne précise pas le sexe des postulants, aucune femme n’a jamais été nommée cadi. Même s’il existe nombre d’avocates, « les femmes préfèrent recourir aux services d’un avocat plaidant de la Charia (qui sont tous des hommes) parce que leurs honoraires sont moins élevés. » [11] La susdite loi de 1961 pose problème, car elle n’exige du cadi aucune formation spécifique en droit de la Charia, ni aucune autre formation juridique. [12] La plupart des cadis exerçant dans les tribunaux de la Charia présentent des lacunes sur le plan de l’éducation académique en Charia comme des connaissances juridiques. [13] C’est un problème surtout, comme nous l’expliquerons plus loin, compte tenu du rôle des cadis dans les tribunaux de la Charia en Israël, dans l’interprétation des textes de loi et dans les décisions de justice.
Les tribunaux de la Charia jouent un rôle crucial dans la vie des musulmans résidant en Israël. Pourtant, des politiques d’allocation budgétaire discriminatoires entravent gravement leur travail. [14] Les crédits que l’État leur alloue sont souvent insuffisants pour faire face aux besoins essentiels des tribunaux, tels que la dotation en personnel et la fourniture de locaux. [15]
La compétence des tribunaux de la Charia en matière de statut personnel est inscrite dans le code ottoman de la famille, première codification étatique du droit musulman de la famille, et dans le code annexe de procédure de la Charia. Ce code a été promulgué en 1917 sous l’Empire ottoman et son application en Palestine remonte à l’année 1919. Il est resté en vigueur après la création de l’État d’Israël en 1948.
Le code ottoman de la famille repose sur l’école de pensée Hanafi, l’une des écoles de pensée sunnites en jurisprudence islamique (fiqh). Il ne s’en réfère pas moins également à d’autres écoles de pensée sunnites. [16] La jurisprudence islamique trouve ses fondements dans la période dite de formation de la civilisation islamique, qui commence à l’époque de la dynastie omeyyade (661-750) et s’étend jusqu’au début du califat abbasside (750-1258). D’après Coulson, cette époque fut le témoin « de tout un cheminement intellectuel qui établit et vérifie les termes de la volonté divine et les agence en un système de droits et devoirs juridiquement applicables. » [17] Le rôle des juristes dans l’élaboration de ce que l’on appelle communément de nos jours la « loi de la Charia » consistait, selon la formule de Mir-Hosseini, à « comprendre la volonté divine afin d’aider les musulmans à ne pas s’écarter du droit chemin. » [18]
L’Empire ottoman a introduit d’importantes réformes en matière de mariage, de divorce et de succession. Mais, le code ottoman de la famille « n’a pas enrayé le système juridique de la Charia, car les réformes ont été mises en œvre par la méthode du takhayyur, la sélection ou combinaison d’éléments de différentes écoles de droit. » [19] Le problème avec l’application contemporaine du code ottoman de la famille dans les tribunaux de la Charia réside dans sa limitation au mariage et au divorce. Il arrive donc très souvent que les juges doivent se reporter aux ouvrages du docteur de la loi Abu Hanifa pour pouvoir trancher certaines questions de statut personnel que le code ottoman de la famille n’aborde pas. En outre, le code de procédure de la Charia annexé au code ottoman de la famille est limité et très difficile à mettre en œvre dans les tribunaux modernes. [20]
Les droits personnels des pays du Moyen-Orient, dont la majeure partie se basent principalement sur le code ottoman de la famille, ont fait l’objet de réformes profondes. Dans le cadre de ces réformes, la plupart des corps législatifs arabes ont évolué au sein de la tradition jurisprudentielle islamique en réponse aux changements socio-économiques. Le code ottoman de la famille appliqué dans les tribunaux de la Charia en Israël n’a pourtant pas été réformé. Layish a affirmé que « pour des raisons évidentes, le législateur israélien ne pouvait guère adopter les techniques législatives du takhayyur (la sélection ou combinaison d’éléments de différentes écoles de droit), entre autres mécanismes coutumiers dans les pays arabes et permettant de conférer aux réformes l’apparence d’une révision interne de la loi religieuse. » [21]
Layish n’a pas spécifié ces « raisons évidentes ». Mais, à notre avis, il s’agissait de plusieurs facteurs dont, en premier lieu, la difficulté de débattre du fiqh dans un parlement non musulman. En second lieu, le gouvernement israélien avait tendance à considérer le droit musulman comme une Sainte Loi qui ne saurait être contestée. En outre, les intérêts de la minorité arabe ne constituaient pas une priorité pour l’État. Enfin, la communauté arabe n’avait pas présenté la réforme de ce code comme une exigence. Nous étudierons ces raisons, et d’autres, plus loin.
Il est important de souligner que le droit personnel n’a pas non plus été réformé sous le mandat britannique. L’existence du code ottoman de la famille explique probablement que les Britanniques n’aient pas jugé nécessaire d’instaurer de nouvelles lois sur la famille, comme ils l’avaient fait en Inde, par exemple. Les Britanniques ont amendé le code pénal ottoman en 1936, notamment touchant l’âge minimal requis pour le mariage et l’âge de majorité civile. Mais, il semble qu’aucune tentative n’ait été faite pour veiller à l’application de ces amendements dans les tribunaux de la Charia. Si les « principes du droit anglais » ont pénétré le système juridique palestinien, leur influence sur l’essence même et l’application de la loi dans les tribunaux de la Charia est moins marquée que dans d’autres domaines. [22]
Le parlement de la Knesset a promulgué des lois civiles sur le statut personnel qui ont force obligatoire dans tous les tribunaux religieux. Il a drastiquement restreint ces lois de deux façons : « Il s’est abstenu d’interférer avec toute interdiction ou autorisation religieuse concernant le mariage et le divorce ; il a adopté des dispositions procédurales et pénales dissuasives, plutôt que des dispositions de fond qui auraient invalidé les lois religieuses en question, ou bien, dans les domaines où il a promulgué des dispositions supplantant la loi religieuse, il a en général offert aux parties la possibilité de plaider conformément à la loi religieuse. » [23]
Voici les principales lois civiles appliquées dans les tribunaux de la Charia :
- Loi sur l’âge du mariage de 1950 ;24
- Loi sur l’égalité des droits des femmes de 1951 qui interdit la polygamie et le divorce contre le gré de la conjointe ; [25]
- Loi sur la pension alimentaire (la garantie de paiement) de 1972 ; [26]
- Loi sur les rapports de propriété entre époux de 1973 et les réformes de 1991.
Si l’on considère généralement que le droit civil laïc apporte des améliorations au statut de la femme, un examen approfondi de sa mise en œvre montre que ce n’est pas toujours le cas. Des ONG de femmes ont mis en évidence les difficultés d’appliquer certaines de ces lois. Selon le rapport sur le statut des femmes palestiniennes en Israël présenté au comité CEDAW en 1997, le mariage des enfants et la polygamie sont autorisés, même si la loi punit ceux qui les pratiquent ou y contribuent. L’introduction de dispositions pénales n’a pas permis d’améliorer la situation des femmes, puisque les autorités n’ont pas appliqué la loi avec efficacité. [27]
Selon Layish, la difficulté d’appliquer les dispositions pénales s’explique en partie par le fait que les citoyens musulmans trouvent l’intervention de la Knesset, une assemblée législative non musulmane, dans ce domaine délicat du statut personnel pour le moins préoccupante. Les musulmans sont très critiques à l’égard des lois de la Knesset. Ils ont l’impression qu’elles sont motivées par le désir de saper la Charia et l’ordre social traditionnel, au point que certains cadis préfèrent les ignorer et restent exclusivement liés aux normes juridiques de la Charia en la matière. [28]
Autre explication, certaines autorités israéliennes tendent à traiter la violation des droits des femmes comme un problème interne à la communauté arabe, auquel elles ne peuvent s’attaquer. Cela se manifeste clairement dans la façon dont la police et la justice gèrent les problèmes de violence domestique en général et les crimes dits « d’honneur » en particulier. [29]
Les femmes, le droit personnel et les tribunaux de la Charia
Comme nous l’avons vu, en Israël, les femmes brillent par leur absence dans les tribunaux de la Charia. Non seulement tous les cadis exerçant dans les tribunaux israéliens de la Charia sont des hommes, mais c’est aussi le cas de tous les avocats plaidants de la Charia. Cette situation n’est pas très différente de celle de la majeure partie des pays musulmans et communautés musulmanes. La plupart du temps, les femmes sont exclues de la sphère religieuse en général et du système judiciaire de la Charia en particulier. [30] La jurisprudence islamique est le produit d’une interprétation masculine. Apanage des hommes, cette discipline permet, dans une large mesure, de justifier les attitudes discriminatoires à l’égard des femmes. [31] L’absence des femmes dans les affaires religieuses facilite, pour les protecteurs auto-désignés de la religion, la tâche de promulguer des décrets qui violent les droits des femmes. [32]
Dans le code ottoman de la famille, fidèle à la doctrine Hanafi, les rapports hommes-femmes reposent sur une conception patriarcale des droits et des devoirs. L’homme y a un statut supérieur ; c’est le chef de famille, celui qui protège la femme et pourvoit à ses besoins. En revanche, la femme y est représentée en inférieure à protéger. Cette vision apparaît dans les articles 71, 101, 151 et 171 qui traitent de l’obéissance. Ces articles définissent le devoir d’obéissance de l’épouse envers son mari et l’obligation pour le mari de payer une pension alimentaire. [33] La même conception ressort des articles régissant le droit de la femme à un douaire et le devoir du mari de le verser. [34] Cet article illustre, comme Mir-Hosseini l’affirme, l’absence d’un régime matrimonial commun dans la loi, une absence qui a eu une profonde influence sur la conception de rapports hommes-femmes hiérarchiques. [35] Les conceptions des relations entre hommes et femmes ne sont pas très différentes d’une école à l’autre. En même temps, les femmes peuvent obtenir différents ensembles de droits selon les écoles de pensée. Par exemple, l’école Maliki reconnaît à la femme plus de motifs d’obtenir la dissolution judiciaire de son mariage que l’école Hanafi.
Bien qu’une analyse textuelle du code ottoman de la famille soit importante, elle ne suffit pas à assurer une compréhension globale du statut de la femme au sein de la justice de la Charia. Le statut de la femme n’est pas figé à cet égard. Des facteurs sociaux, économiques et politiques interviennent. D’autres types de discours juridique l’imprègnent également. Dissocier le texte de loi d’autres facteurs qui façonnent le statut de la femme aux yeux de la justice de la Charia est impossible. Il est en outre important d’en examiner les applications et d’évaluer leur correspondance avec les réalités des femmes. [36]
Alors que les relations entre hommes et femmes, en vertu du code ottoman de la famille, reposent sur une conception patriarcale des droits et des devoirs, les femmes peuvent manipuler le système judiciaire patriarcal et négocier leurs droits, parfois à l’aide des termes mêmes qui les représentent comme inférieures. Kandiyoti nomme cette pratique la « négociation patriarcale. » [37] Une étude des décisions arbitrales rendues par la Cour d’appel de la Charia en Israël l’a récemment mise en évidence : les femmes s’adressent à la justice pour faire valoir leurs droits financiers ou obtenir la dissolution de leur mariage, parfois à l’aide des termes mêmes qui les représentent comme inférieures. [38] Les droits financiers accordés aux femmes en vertu de la Charia sont particulièrement importants pour celles qui ne disposent d’aucun autre moyen de subsistance. À notre avis, c’est dans la correspondance de la justice de la Charia avec la réalité des femmes que se trouve son pouvoir.
J’aborde ici brièvement certains des facteurs qui façonnent les différentes réalités des femmes dans les tribunaux de la Charia.
1. Le rôle du cadi
Le cadi joue un rôle décisif dans un large éventail de questions. En Israël, son rôle s’avère encore plus central du fait que les tribunaux de la Charia opèrent dans un État non musulman qui n’a pas tenté, et n’aurait pu tenter, de réformer les lois musulmanes sur le statut personnel. Son pouvoir discrétionnaire est dès lors très grand, n’étant limité que par de rares points de référence. [39]
Les cadis ne réagissent pas de la même façon à l’absence, dans le code ottoman de la famille, de réponse définitive aux questions que soulève la société contemporaine. Ils gèrent aussi différemment les problèmes au carrefour du code ottoman de la famille et des pratiques modernes. Selon les propres termes de Layish, « le degré d’orthodoxie, le niveau d’instruction, la formation judiciaire, le regard sur la société et la mesure de compréhension » qu’ils affichent déterminent leur ligne de conduite et ils sont « motivés par la maslaha (l’intérêt général). » [40]
Les recours en justice des femmes dépendent donc pour une grande part de la ligne de conduite du cadi saisi de l’affaire. Il y a néanmoins plus de risque que leurs intérêts, parfois dictés par leur sexe, ne soient déniés, du fait de leur situation inégale dans la société. La définition de l’« intérêt général » peut donc exclure leurs différents intérêts.
2. Les différences entre les femmes
La classe sociale, l’âge et le niveau d’instruction jouent sans doute un rôle important dans les répercussions des décisions de justice sur les femmes. De tels facteurs peuvent s’avérer décisifs pour l’obtention de certains droits, par exemple, dans les cas où les femmes ont dû renoncer à une partie de leurs droits économiques pour obtenir la dissolution judiciaire de leur mariage. [41] À l’examen des décisions de la Haute cour d’appel de la Charia, il ressort que, dans la majorité des cas, faire valoir le droit à la dissolution judiciaire du mariage revient pour les femmes à lutter pour leur droit au douaire. La perte partielle ou totale du droit au douaire suite à l’obtention de la dissolution judiciaire a des conséquences différentes sur les femmes selon qu’elles sont issues d’une classe sociale modeste, se trouvent sans emploi ou ne disposent d’aucun autre moyen de subsistance. Ce point pourrait même faire obstacle à leurs droits à la dissolution du mariage. [42]
3. La loi laïque
Le rôle de la loi laïque dans l’amélioration du statut de la femme est contesté. [43] D’un côté, la loi laïque fournit aux femmes un nouveau mécanisme qui leur permet d’obtenir leurs droits par la menace de sanctions pénales. Mais, l’assertion de Layish selon laquelle la loi laïque « rompra l’équilibre traditionnel, ancré dans la loi islamique, entre les droits et les devoirs des conjoints » [44] est discutable. Un examen approfondi des jugements rendus en matière de divorce et de dissolution judiciaire révèle que l’interdiction de divorcer contre le gré de la conjointe oblige les hommes à utiliser d’autres moyens pour négocier leurs intérêts. Pour éviter une éventuelle sanction pénale en cas de dissolution du mariage sans le consentement de leur épouse, ils peuvent en appeler à l’article 130 du code ottoman de la famille. Cet article accorde aux deux époux l’initiative de la dissolution du mariage pour cause de « discorde ». [45] En pareils cas, les hommes négocient leurs droits dans le cadre du système patriarcal qui définit leurs droits et devoirs, et donc leurs rapports avec l’autre sexe. [46] Il faut remarquer que le code ottoman de la famille avait pour objet d’accorder aux femmes l’accès au divorce dans des circonstances particulières et qu’il reste, dans la plupart des pays, le seul moyen à leur disposition pour mettre fin à leur mariage sans le consentement de leur mari. En Israël, cependant, les hommes musulmans en appellent à cette loi pour échapper aux sanctions juridiques auxquelles les expose leur pratique du divorce unilatéral. La situation est différente en Cisjordanie, par exemple, où le divorce unilatéral ne fait l’objet d’aucune interdiction et où quasiment toutes les demandes de dissolution judiciaire sont le fait des femmes. [47]
Comme démontré plus haut, le statut de la femme au sein de la justice de la Charia n’est pas figé. Dans tout litige, interviennent divers facteurs qui se conjuguent pour former les différentes réalités des femmes aux yeux de la justice. Cela ne veut pas dire que les femmes, en tant que catégorie, ne souffrent pas de discrimination au sein du système judiciaire de la Charia. Loin s’en faut. Leur situation et positionnement au sein de la société influe considérablement sur les jugements que rend cette institution dominée par les hommes. Il convient de souligner que les rapports entre les femmes et l’appareil judiciaire ne relèvent pas d’un contrat entre individus libres et autonomes. Ces rapports s’inscrivent plutôt dans le cadre plus large des relations familiales et communautaires. [48]
Le droit personnel musulman et la conception de la citoyenneté en Israël
Le pouvoir absolu des tribunaux religieux en matière de mariage et de divorce illustre le fait qu’en Israël la citoyenneté d’un individu s’inscrit uniquement dans le cadre de sa communauté religieuse. Le pouvoir absolu des communautés religieuses implique que, selon les termes de Joseph, « l’appartenance à une secte religieuse n’est pas un fait de volonté, mais une condition d’obtention de la citoyenneté. » [49] Mariage et divorce sont impossibles sans l’entremise des communautés religieuses ; il n’existe ni mariage ni divorce civil en Israël. La possibilité qu’ont les citoyens de s’adresser à un tribunal des affaires familiales de l’État pour certaines questions de statut personnel n’exclut pas totalement l’intervention des communautés religieuses, puisque l’État d’Israël est un État juif. Dans certains cas, par exemple pour les questions de pension alimentaire à verser à l’épouse qui sont régies par les lois religieuses, la Cour d’État applique la loi de la religion des requérants, même dans un tribunal des affaires familiales.
Certains ont prétendu qu’Israël, en soumettant le droit personnel au pouvoir absolu des tribunaux religieux, a régulé les « affaires publiques », mais a laissé les affaires dites « privées » à la communauté. Ce n’est pas le cas. Certes, l’État n’exerce pas un contrôle direct sur le « domaine privé ». Mais, il régit ce domaine par l’entremise d’institutions religieuses non étatiques. Il en résulte une pluralité d’institutions juridiques. Celles-ci sont complètement indépendantes les unes des autres, mais l’État les régule indirectement. Le contrôle de l’État sur les tribunaux religieux se reflète dans l’imposition du droit civil aux tribunaux religieux. En outre, l’État nomme les juges et réglemente leurs qualifications. Les tribunaux sont également subordonnés au ministère des Affaires religieuses, exclusivement contrôlé par les partis politiques religieux juifs. De plus, il est possible de faire appel aux décisions de la Haute cour de la Charia auprès de la Cour suprême d’Israël.
La pluralité des institutions juridiques en Israël n’est pas la même qu’au Liban, par exemple. À la création de l’État libanais, chacune des 17 sectes religieuses est devenue une sous-communauté à part entière et disposant de droits propres. [50] Par contre, en Israël, une seule sous-communauté (juive) s’est identifiée à l’État tandis que les autres ont perdu leur autonomie et ont été reléguées dans une catégorie résiduelle (« non juive »). Toutes sont soumises à la compétence juridictionnelle et au contrôle de l’État israélien qui, par définition, est juif et se préoccupe des intérêts juifs. [51]
Le contrôle du « domaine privé » par le biais des institutions religieuses s’inscrit dans le projet de l’État qui cherche à réguler ses rapports avec la minorité arabe par le biais de structures de médiation traditionnelles, les institutions religieuses dans le cas présent. L’État donne aux chefs religieux pouvoir sur le reste de la communauté sans cependant leur accorder une autonomie complète dans le domaine dit « privé ». Disons plutôt qu’il régule le « domaine privé » par leur entremise.
La pluralité des autorités judiciaires religieuses arabes s’inscrit dans le projet de l’État : elle permet d’appréhender la minorité nationale palestinienne comme une série de minorités religieuses. L’État souligne ainsi l’identité religieuse des citoyens palestiniens tout en évitant l’élaboration d’une plate-forme commune pour tous, notamment pour les femmes qui ont probablement plus d’intérêt à contester les questions relatives au droit de la famille.
Le rôle de médiation des citoyens que jouent les communautés religieuses soulève des questions primordiales sur la citoyenneté des femmes. Les femmes ne se trouvent pas en situation d’égalité au sein des communautés religieuses, ni des institutions religieuses telles que les tribunaux de la Charia. En reconnaissant l’autorité des tribunaux religieux en matière de droit personnel, Israël a soumis les femmes à l’autorité de leurs parents masculins par le biais d’une loi qui les représente comme inférieures. De plus, l’État n’a ni réformé la loi ni proposé d’alternatives laïques pour désavouer cette conception. Il n’a pas, non plus, élaboré de mécanisme susceptible de garantir les droits à l’égalité des femmes, les citoyennes de l’État, lorsque les lois religieuses violent leurs droits humains. Au contraire, l’État a émis une réserve à l’endroit du droit fondamental des femmes à l’égalité en subsumant leurs droits sous la loi religieuse. Cette réserve est possible parce que l’égalité des sexes n’a pas le statut de droit fondamental ; il s’agit plutôt d’un « principe fondamental », comme l’a énoncé la Cour suprême en 1987, et sa primauté constitutionnelle n’a pas encore été établie. [52]
La primauté de la loi religieuse sur l’égalité est le fruit d’un compromis politique entre les partis religieux juifs qui font toujours partie de la coalition gouvernementale. Ces partis politiques religieux ont su imposer un certain respect de la loi juive à tous les Juifs résidant en Israël. C’est là le résultat d’un accord que l’on nomme le « statu quo ». Remontant à l’instauration de l’État, il permet aux tribunaux religieux juifs (et, partant, aux tribunaux religieux musulmans, druzes et chrétiens) de conserver la compétence en matière de statut personnel. Cet accord était un compromis politique échafaudé par les fondamentalistes juifs aux dépens des femmes.
En accordant à loi religieuse la primauté sur les principes d’égalité, l’État a renforcé le « patriarcat privé » qui se trouve intégré dans les liens de parenté. Cette notion de patriarcat est différente de celle qu’utilisent communément les universitaires féministes occidentales dont Pateman (1988) et Walby (1994). Elle se distingue du « patriarcat public » que décrit Walby, où les femmes ne sont plus, selon elle, exclues de l’arène publique, mais subordonnées en son sein. [53] Il ne s’agit pas non plus du « patriarcat politique » qui, selon Pateman, de paternaliste devient fraternaliste. Ici, l’État renforce un patriarcat intégré dans les liens de parenté. [54]
En soumettant le droit personnel aux tribunaux religieux et en limitant les alternatives juridiques laïques, l’État a conféré aux relations familiales, et notamment aux rapports hommes-femmes, un caractère sacré, ce qui rend toute contestation en la matière très difficile. [55] L’État israélien tend à considérer l’inégalité entre les hommes et les femmes dans la loi religieuse comme un principe immuable et incontestable. C’est dû à une approche mythique selon laquelle les lois religieuses sont des lois divines, plutôt que le produit d’une interprétation humaine, en l’occurrence des hommes. En témoignent les réserves que l’État, à l’instar de la plupart des pays arabes, émet à l’endroit de certains articles de la convention CEDAW sur l’égalité en matière de statut personnel. Dans le cas d’Israël, la réserve relative à l’article 7b de la convention CEDAW, qui concerne la nomination de femmes juges dans les tribunaux religieux, se justifie par le fait que les religions des diverses communautés présentes en Israël l’interdisent. [56] Ce n’est bien évidemment pas strictement exact, du moins pour ce qui est des femmes musulmanes. Un examen approfondi du débat en la matière au sein de la jurisprudence musulmane révèle que les femmes peuvent être nommées juges dans les tribunaux de la Charia, et de fait, le sont dans certains pays, comme nous l’avons déjà mentionné. [57] Les femmes ont tenté de protester contre le manque de femmes juges dans les tribunaux de la Charia en Israël et ont présenté une requête à la Cour suprême pour obtenir la nomination de femmes cadis. Mais, leur requête s’est vue opposer une fin de non-recevoir sur le motif que la loi même sur laquelle elles fondaient leur requête, la loi sur l’égalité des droits des femmes de 1951, n’était pas applicable aux postes à pourvoir dans les tribunaux religieux. [58]
La lutte contre l’inégalité des sexes dans le système judiciaire de la Charia d’Israël pose problème puisque ses tribunaux opèrent dans un État non musulman. En effet, comme nous l’avons déjà expliqué, le parlement national est juif. Il ne dispose donc pas du mécanisme utilisé dans d’autres États du Moyen-Orient pour réformer les conceptions patriarcales du droit musulman de la famille au travers de réformes au sein du discours religieux. En outre, comme développé plus haut, les problèmes de la minorité arabe en général, et des femmes arabes en particulier, ne font pas partie des préoccupations du gouvernement israélien pour lequel l’« intérêt général » diffère selon le sexe [59] et la race.
Bien que la possibilité de réformer le droit personnel au sein du discours religieux ait fait l’objet de maints débats dans le monde arabe, ce point n’a pas figuré au nombre des exigences de la communauté palestinienne. Les féministes palestiniennes et les organisations de défense des droits humains n’ont en outre commencé à contester l’immutabilité du droit personnel que depuis peu. Il existe plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, la communauté palestinienne, comme d’autres, tend à conférer au droit personnel un caractère sacro-saint et inaltérable. Deuxièmement, le droit personnel, essentiellement axé autour des rapports hommes-femmes, est désormais considéré comme le dernier bastion de la dominance masculine et s’avère étroitement lié avec l’« identité de groupe » palestinienne. Dès lors, toute contestation de cette structure patriarcale semble menacer cette identité. Troisièmement, la communauté palestinienne d’Israël n’a mené aucune étude de la jurisprudence musulmane suite à l’effondrement de l’establishment islamique après la guerre de 1948 et au départ consécutif des muftis et des oulémas qui auraient pu entreprendre une telle tâche. (Nous ne nions pas qu’ils puissent s’opposer à de telles réformes ou faire valoir les « saints ordres » ; il s’agit ici de souligner leur « aptitude » en la matière, le fait qu’ils pourraient constituer une référence.) Enfin, l’isolement des Palestiniens d’Israël, notamment des groupes féministes, par rapport au reste du monde arabe et à ses centres culturels les a exclus des débats sur le sujet. Cet isolement a par la suite limité leurs possibilités d’acquérir les compétences requises pour entreprendre une telle tâche.
Il convient de mettre en relation la subordination de l’égalité des femmes musulmanes, en particulier par la loi religieuse, avec le projet politique de l’État et son intégration de forces sociales s’inscrivant dans des contextes historiques différents. Swirski décrit le phénomène en ces termes : « un exemple d’alliance entre les hommes (les représentants des autorités juives et les chefs musulmans de familles élargies) au détriment des femmes musulmanes sur lesquelles les hommes juifs ont autorisé les hommes musulmans à maintenir un contrôle strict. » [60] Elle souligne le fait que les femmes musulmanes divorcées, contrairement aux juives, ne peuvent pas déclarer leurs jeunes enfants sur leur passeport sans la signature de leur ancien mari. Et de conclure : « les hommes juifs du ministère israélien de l’Intérieur semblent avoir conspiré avec les hommes musulmans contre les femmes musulmanes. » [61]
Nous convenons de la formation d’un compromis politique aux dépens des femmes. La loi religieuse a primé sur l’égalité dans un compromis politique entre les partis juifs religieux et socialistes. Certains partis politiques juifs religieux ont, de plus, soutenu les partis arabes opposés à l’accès des femmes palestiniennes à la justice civile. Mais, la thèse de Swirski d’une conspiration des hommes juifs et musulmans contre les femmes musulmanes est douteuse. Dans cette thèse, la subordination des femmes trouve ses racines dans la personne des hommes au lieu de découler de la structure de contrôle imposée aux femmes, au bénéfice des hommes. [62] En outre, cette formulation implique également des pratiques unitaires de la part des forces sociales et de l’État, qui soient uniquement motivées par les intérêts des hommes. À notre avis, comme Anthias et Yuval-Davis l’affirment, ni l’État ni la société civile ne font preuve d’unité ; leurs pratiques sont plutôt pleines de contradictions. [63] Dans certains cas, par exemple, un compromis politique est possible entre différents partis au détriment des femmes. Dans d’autres, en situation de minorité-majorité ou coloniale par exemple, le groupe dominant (majoritaire ou colonisateur) peut se servir de la cause des femmes pour saper la culture du groupe marginalisé (minoritaire ou colonisé). [64] La thèse de Swirski implique également que le statut de la femme repose sur des coalitions patriarcales motivées par les intérêts des hommes. Nous venons cependant d’exposer une réalité différente : le statut des femmes palestiniennes résulte du fait que le projet de citoyenneté d’Israël tient compte non seulement du sexe, puisqu’il correspond aux intérêts des hommes, mais aussi de la race, puisqu’il correspond aux intérêts des Juifs (au sens de l’idéologie sioniste). D’autres divisions sociales, de classe et d’âge par exemple, peuvent également influer sur la citoyenneté.
Conclusion
L’étude du droit personnel, qui touche essentiellement à la famille, et de l’autorité absolue des tribunaux religieux en matière de statut personnel en Israël montre que la citoyenneté de l’individu est déterminée par l’entremise de sa communauté religieuse. Cela implique que l’appartenance à une communauté religieuse est une obligation impérative si l’on veut obtenir la citoyenneté, et non un choix volontaire.
Le projet de citoyenneté israélien présente un biais sexuel puisque les femmes ne sont pas sur un pied d’égalité avec les hommes dans leur communauté comme dans les institutions religieuses telles que la justice de la Charia en l’occurrence. Il véhicule une conception des femmes qui les relègue sous une classe de citoyens dont les droits fondamentaux à l’égalité sont subordonnés à un droit de la famille patriarcal. Cependant, si les femmes palestiniennes ne se trouvent pas en situation d’égalité dans les tribunaux de la Charia, leur statut n’est pas non plus figé. Divers facteurs se conjuguent pour façonner les réalités variables des femmes aux yeux de la justice. Les rapports entre les femmes palestiniennes et l’appareil judiciaire ne relèvent pas d’un contrat entre individus libres et autonomes, car le statut des femmes palestiniennes s’inscrit dans les relations familiales et communautaires. Nous avons fait valoir que le patriarcat est, dans ce cas, renforcé par l’État et intégré dans les liens de parenté.
Ce document souligne que le statut des femmes palestiniennes est influencé par le biais sexuel et racial que présente le projet de citoyenneté israélien.
Remerciements
Cet article fait partie du mémoire de maîtrise de Mme Rouhana, intitulé « Personal Status Laws and The Citizenship of Palestinian Women in Israel » et soutenu à la Greenwich University de Londres, en 2002.
Notes
- M. Helie-Lucas, « The Preferential Symbol for Islamic Identity: Women in Muslim Personal Laws », paru sous la réf. suivante : M. Valentine (éd.), Identity Politics and Women: Cultural Reassertions and feminisms in International Perspective (Boulder : Westview Press, 1994), pp. 391-407.
- Le droit musulman de la famille peut également établir la citoyenneté des femmes au-delà de l’État. Par exemple, au Pakistan, l’ordonnance sur le droit musulman de la famille de 1961 a un caractère extraterritorial et s’applique aux citoyens du Pakistan résidant à l’étranger.
- Adalah (le centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël), Legal Violation of Arab Minority Rights in Israel (Shfa-Amer : Adalah, 1998) p. 7.
- A. Bishara, La rupture du discours politique et autres études (en arabe), (Palestine : Muwatine, 1998), p. 15.
- Adalah, Report to WCAR in Durban (rapport non publié, Shfa-Amer : Adalah, 2001), p. 3.
- Cf. Adalah, op. cit. (3), p. 35 ; N. Abdo et N. Yuval-Davis, « Palestine, Israel and the Zionist Settler Project », paru sous la réf. suivante : D. Stasiulis et N. Yuval-Davis (éds), Unsettling Settler Societies, (Londres : Sage, 1995), p. 306. Pour plus d’informations sur les citoyens palestiens d’Israël, cf. N. Rouhana, Palestinian Citizen in an Ethnic Jewish State: Identity in conflict (New Haven et Londres : Yale University Press, 1997).
- Groupe de travail sur le statut des femmes palestiniennes en Israël, rapport des ONG au comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) intitulé « The Status of Palestinian Women Citizens of Israel » (Nazareth : 1997), p. 65.
- Ibid., p. 66.
- A. Layish, « The Status of the Shari’a in a Non-Muslim State, the Case of Israel », Asian and African Studies, vol. 27, 1993, p. 172.
- Y. Reiter, « Qadis and the Implementation of Islamic Law in present Day Israel », paru sous la réf. suivante : R. Gleave et E. Kermeli (éds), Islamic Law: Theory and Practice (Londres : I.B. Tauris Publisher, 1997), p. 205.
- Adalah, Rapport sur les femmes et les tribunaux religieux (en arabe, rapport non publié, Shfa-Amer : Adalah, 2000), p. 12.
- L’article 2 de la loi de 1961 stipule qu’un cadi doit être musulman, avoir plus de 30 ans et être ou avoir été marié. Citoyen d’Israël, il est tenu d’observer des mœurs qui conviennent au poste d’un cadi de l’État d’Israël et doit justifier d’une expertise acceptable en droit de la Charia. Cependant, contrairement à la loi de 1963 sur la nomination des avocats plaidants de la Charia, la loi sur la nomination des cadis ne définit pas ce qu’est une « expertise acceptable ». Cf. M. Nator, Une compilation des lois appliquées dans les tribunaux de la Charia en Israël, (en arabe, Ramallah : Matba’at alwehda, 1996), p. 13.
- A. Layish, op. cit. (9), p. 180.
- The State Comptroller Report, (Jérusalem : presse officielle du gouvernement d’Israël, 1996).
- Adalah, op. cit. (11), p. 6.
- L. Welchman, Beyond the Code: Muslim Family Law and the Shari’a Judiciary in the Palestinian West Bank (New York : Kluwer, 2000), pp. 43-44.
- Z. Mir-Hosseini, Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law (Londres : I.B.Tauris Publishers, 2000) p. 5.
- Ibid., p. 5. S’il existe nombre d’écoles de pensée sunnites, seules les quatre principales sont appliquées : Hanafi, Hanbali, Shafi et Maliki. L’école Hanafi est appliquée dans la majeure partie des pays du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud, mais le code promulgué s’inspirait également de l’école de pensée sunnite.
- A. Layish, op. cit. (9), p. 173.
- Adalah, op. cit. (11), p. 3.
- A. Layish, op. cit. (9), p. 174.
- L. Welchman, op. cit. (16), pp. 44-45.
- A. Layish, op. cit. (9), p. 174.
- Cette loi a fait passer l’âge du mariage pour les femmes de 15 ans, comme stipulé dans la loi du mandat britannique, à 17 ans, comme dans le code ottoman de la famille.
- Selon cette loi, tout contrevenant à cette interdiction est passible d’une peine. Cette loi permet également à la mère d’être le tuteur naturel de ses enfants, au même titre que leur père, même si le tribunal religieux peut en décider autrement s’il estime que tel est l’intérêt de l’enfant. La loi sur la capacité et la tutelle de 1962 complète et développe le principe de tutelle naturelle des deux parents et relève à 18 ans l’âge auquel la tutelle prend fin pour les deux sexes.
- Selon cette loi, c’est désormais à l’Institut national d’assurance, dont la tâche consiste à collecter la dette auprès du conjoint, qu’il incombe de payer la pension alimentaire fixée par le tribunal. Les femmes peuvent ainsi accéder à leur droit à la pension alimentaire sans tarder et sans devoir entamer d’autres démarches judiciaires.
- Groupe de travail sur le statut des femmes palestiniennes en Israël, op. cit. (7), pp. 66-69.
- A. Layish, op. cit. (9), pp. 167-183.
- Groupe de travail sur le statut des femmes palestiniennes en Israël, op. cit. (7), p. 73.
- Les seuls pays où des femmes ont été nommées cadis dans des tribunaux de la Charia sont les Philippines, où une femme est cadi, et l’Indonésie, où l’on en compte une centaine. Il existe, en outre, des femmes oulémas (théologiens musulmans), en Iran et dans certains pays d’Afrique tels que le Nigeria. Ces femmes oulémas n’ont cependant aucun lien avec l’État.
- A. An-Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Syracuse, New York : Syracuse Univ. Press, 1990) ; F. Bennani, « The Feminist Voice in the Religious Discourse », présentation donnée dans le cadre d’une formation Mashriqiyat intitulée « Personal Status Laws: The Text Between Reading and Reciting » (Gaza, 22-28 août 2000) ; R. Hassan, Selected Articles (Grabels : Femmes sous lois musulmanes, 1994) ; H. Hoodfar, « Iranian Women at the Intersection of Citizenship and Family Code, The Perils of ‘Islamic Criterion’ », paru sous la réf. suivante : S. Joseph (éd.), Gender and Citizenship in the Middle East (New York : Syracuse University Press, 2000), pp. 287-313.
- F. Bennani, op. cit. (31), pp. 2-3.
- Adalah, op. cit. (11), pp. 13-14.
- Cf. M. Nator, op. cit. (12).
- Z. Mir-Hosseini, op. cit. (17), pp. 193-194.
- Ibid., pp. 1-2 ; A. Moors, « Debating Islamic Family Law: Legal Texts and social Practices », paru sous la réf. suivante : M. Meriwether et J. Tucker (éds), Social History of Women and Gender in the Modern Middle East (Boulder : Westview Press, 1999), pp. 142-149.
- D. Kandiyoti, « Islam and Patriarchy: a Comparative Perspective », paru sous la réf. suivante : N. Keddie et B. Baron (éds), Women in Middle Eastern History (New Haven : Yale, 1999).
- H. Rouhana, « Practice in the Sharia High Court of Appeal in Israel: Gendered Reading of Arbitration Decisions », Dossier 25 WLUML, 2003), pp. 49-69. http://www.wluml.org/english/pubsfulltxt.shtml?cmd[87]=i-87-36655
- A. Layish, Women and Islamic Law in a Non Muslim State (Jérusalem : Keter, 1975) ; A. Layish, op. cit. (9) ; Adalah, op. cit. (11).
- A. Layish, op. cit. (9), pp. 180-181.
- Cf. l’article 130 qui définit la dissolution judiciaire dans la réf. suivante : M. Nator, op. cit. (12).
- Les décisions de la Haute cour d’appel de la Chari’a publiées dans « Une compilation des décisions de la Haute cour d’appel de la Charia entre 1993 et 1997 », Alkashaf (en arabe, Jérusalem : Haute cour d’appel de la Charia, 1999).
- Z. Mir-Hosseini, op. cit. (17)
- A. Layish, op. cit. (39)
- La « discorde » désigne une forme grave d’abus de la part de l’une ou l’autre des parties, au point qu’il devient impossible de poursuivre la vie conjugale.
- Les décisions de la Haute cour d’appel de la Charia, op. cit. (42).
- L. Welchman, Islamic Family Law: Text and Practice in Palestine (Jérusalem : Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, 1999). p. 169.
- S. Joseph (éds), op. cit. (31) ; S. Joseph, « The Public/Private: The Imagined Boundary in the Imagined Nation/State/Community: The Lebanese case », Feminist Review, n° 57, 1997.
- S. Joseph, « Gender and Citizenship in the Middle East », Middle East Report, n° 198, janvier-mars (1996).
- S. Joseph, op. cit. (48).
- B. Swirski, « The Citizenship of Jewish and Palestinian Arab Women in Israel », paru sous la réf. suivante : S. Joseph (éd.), op. cit. (31), p. 316.
- F. Raday, « The Concept of Gender Equality in a Jewish State », paru sous la réf. suivante : B. Swirski et M. Safir (éds), Calling the Equality Bluff: Women in Israel (New York : Teachers College Press, 1993) p. 19.
- S. Walby, « Is citizenship gendered? », Sociology, 28/2, 1994, pp. 397-395.
- C. Pateman, The Sexual Contract (Cambridge : Polity, 1988).
- S. Joseph, op. cit. (48).
- Rapport de l’État d’Israël au comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (Jérusalem : ministère de la Justice et ministère des Affaires étrangères, 1997).
- N. Moosa, « Women’s Eligibility for Qadiship (judgeship) », Awraq Journal (Espagne : ministère des Affaires étrangères, 1998), vol. XIX, pp. 203-227.
- Suliman Myriam v the Committee for Appointing Qadis, 1008/01, 2001, (Jérusalem : la Cour suprême, le 8 février 2001).
- B. Swirski, op. cit. (51), p. 315.
- Ibid., p. 323.
- Ibid., p. 324.
- A. Chhahachi, « Forced Identities: the state, communalism, fundamentalism and women in India » paru sous la réf. suivante : D. Kandiyoti (éd.), Women, Islam and the State (Londres : Macmillan, 1991), p. 149.
- F. Anthias et N. Yuval-Davis (éds), Women-Nation-State (Londres : Macmillan, 1989), p. 5.
- L. Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (New Haven : Yale University Press, 1992) ; R. Hensman, Oppression within Oppression: the Dilemma of Muslim Women in India, Femmes sous lois musulmanes, document de travail n° 1, 1987.