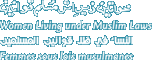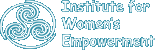France: Politique de la ville - trente ans de traitements d'urgence
Source:
Libération Besoins de logements, violences à répétitions, c'est à partir de 1975 que les gouvernements commencent à se pencher sur les problèmes urbains. Retour sur trois décennies d'actions menées sans cohérence.
HLM et ZUP dans tous leurs états, les habitants oubliés. L'intégration des jeunes beurs à marche forcée. La création d'un grand ministère. De 1975 à 2005 : visite de la politique de la Ville en quatre grandes étapes.
Le traitement par le béton
Dans les années 1960-1973, le béton coule à flots dans la périphérie des grandes villes. On construit jusqu'à 600 000 logements par an. Les grues sont partout pour juguler la crise du logement, pour résorber les bidonvilles comme à Nanterre ou à Villeurbanne, ou voit le jour le ministre Azouz Bégag. On bâtit aussi pour loger les rapatriés d'Algérie et les travailleurs des bassins industriels qui font appel à une main d'oeuvre étrangère abondante. C'est ainsi que naît le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie où «7 000 logements sont créés de toutes pièces sur le terrain d'un ancien aérodrome», rappelle Pierre Bédier l'ex-maire (UMP). Pour mener ses programmes, l'Etat créé des ZUP (Zone d'urbanisation prioritaire) souvent dénuées de commerces ou de services publics, vite rebaptisées «cité dortoirs». La plupart d'entre elles deviendront au fil des années des ZUS (Zones urbaines sensibles), objet de la politique de la ville. Traduction aujourd'hui, 717 quartiers représentant 4,5 millions d'habitants et une addition de difficultés : chômage de masse de 20 à 30 %, spécialement parmi les jeunes, familles aux revenus précaires, échec scolaire, déliquance... Tous les voyants sont au rouge. Le tout donnant aux habitants de ces quartiers le sentiment d'être victimes de discriminations et d'injustices.
A l'origine : le premier choc pétrolier et la progression du chômage frapperont en premier lieu ces quartiers, habités souvent par des salariés non-qualifiés sacrifiés sur l'autel des restructurations industrielles. Les parents perdent leur statut et leur enfants leurs repères. Face à cette réalité, la politique de la Ville consistera en une série d'atermoiements. On met d'abord le cap sur le bâti et la réhabilitation des immeubles. Dès 1977, Jacques Barrot, secrétaire d'Etat au Logement du gouvernement Barre, lance un Plan banlieue avec de conventions Habitat et vie sociale qui financent des programmes de rénovation de HLM. Ce traitement de problèmes humains par l'urbain est manifestement très ancré dans les esprits, puisque la loi Borloo d'août 2003, dotée pourtant d'un budget de 30 milliards d'euros sur cinq ans, est totalement centrée sur la question des tours et des barres qu'il faut faire tomber à coup de bulldozer. «Donner un meilleur cadre de vie aux gens, personne ne contestera ça. Mais on ne règle en rien les problèmes de fond des familles, c'est à dire l'emploi, l'insertion, et les questions éducatives», critique une responsable associative de Seine-Saint-Denis, département particulièrement touché par la flambée de ces derniers jours.
Une flambée qui en rappelle d'autres. Cela a commence il y a presque un quart de siècle, en juillet 1981. C'est «l'été chaud» dans la banlieue lyonnaise. Dans la cité des Minguettes, à Vénissieux, des jeunes se livrent à des rodéo et brûlent 250 voitures. L'Etat a sa réponse. Achevées dix sept ans plus tôt (en 1966), les Minguettes vont subir un premier traîtement de choc. Trois tours sont dynamitées en 1983, dont une en présence du président Mitterrand. A l'époque, on considère que la France compte 22 quartiers à «problème». Mais dans les mois suivant, la liste va très vite grossir pour atteindre les 148. Et comme les jeunes sont le fer de lance de la révolte, on ajoute à l'urbain une couche de politique éducative. En 1981, Alain Savary, ministre de l'Education, annonce la création de Zones d'éducation prioritaires (ZEP). Le dispositif est prévu pour durer quatre ans et concerne 363 ZEP. Vingt-quatre ans plus tard, 911 ZEP scolarisent 20 % des élèves. Dernier pilier : la sécurité. Mais là, au grès des ministres successifs, on passera du plan de prévention de la délinquance concocté en 1982 par Gilbert Bonnemaison, député-maire PS d'Epinay-sur-Seine, (avec 64 axes, contrats d'action dans les quartiers) aux politiques axés sur la répression de Pasqua (1986-1988) ou de Sarkozy.
En juillet 1991, Delebarre (lire ci-contre) fait voter la loi d'orientation pour la ville (LOV), qui oblige les communes ayant peu de HLM sur leur territoire à en construire, afin de mieux répartir les logement sociaux et d'éviter la constitution de ghettos. Une loi qui sera vidée de sa subtance par la gouvernement Balladur. Celui de Juppé a sa réponse, libérale : il crée 41 Zones franches urbaines (ZFU) pour inciter les entreprises à s'installer dans des ZUS (exonération d'impôt sur les bénéfices, sur les charges sociales). 700 quartiers sont classés ZUS. Un plan de «100 000 emplois-ville» destinés aux 18-25 ans est annoncé. Aucun bilan ne suivra.
Les soubresauts de la politique d'intégration
La gauche crée en 1983 le Conseil national de prévention de la délinquance (CNDP), puis décline la structure dans les départements, dans les villes. Mais ça ne suffit pas. Dans les quartiers, fils d'Algériens et de Marocains sont victimes de racisme. Le 13 juillet 1983, à la Courneuve, un habitant excédé tue un enfant de 9 ans, Toufik, tiré comme un pigeon. A l'automne, une quinzaine de jeunes des Minguettes acteurs de l'été chaud de 1981 organisent la Marche des Beurs et scandent «La France, c'est comme une mobylette, pour avancer, faut du mélange !». La manifestation «pour l'égalité et contre le racisme» rassemble 100 000 «black-blanc-beur» à Paris, où le Président reçoit les leaders, accorde à tous une carte de séjour et de travail valable dix ans. Ce mouvement spontané de la jeunesse arabe représente un espoir formidable. En octobre 1984 est lancé SOS Racisme, avec le slogan «Touche pas à mon pote». «Mais ces deux références n'ont jamais vraiment gravi les marches du pouvoir : la gauche a raté une occasion incroyable, dit René Rousseau de la CFDT inter-co (logement, pompiers, policiers, AS, etc). Les banlieues ont été traitées comme du social, jamais de manière politique. On a mis les immigrés à l'écart, et on les y a laissés. Les hommes politiques se sont repassés le grisby des banlieues comme une patate chaude.» L'arrivée de Charles Pasqua à l'Intérieur en 1986, dans un contexte d'attentats chez Tati, avec la répression des manifestations étudiantes contre la loi Devaquet mort de Malik Oussekine suscitent un climat de tension dans les banlieues. C'est la fin de la prévention. Les «marcheurs» pour l'égalité qui ont y cru finissent «dégoutés par les politique, écoeurés» selon Yazid Kherfi (lire page 10). Les «grands frères» baissent les bras. En 1989, de jeunes musulmans reprennent en main petits toxicos et voleurs, montent des salles de prières, parfois dans des caves. A Vénissieux, Toumi Djaïdja, le héros de la «marche des Beurs» a fait le «retour» à l'islam, tient un atelier de couture, a coupé ses boucles brunes, laissé poussé sa barbe : «Je mène le même combat, j'ai simplement changé d'étendard.»
A Creil, éclate la première affaire du voile islamique : trois jeunes musulmanes sont exclues de leur collège pour avoir refusé de retirer leur foulard en classe. Jospin, alors ministre de l'Education, temporise : l'école accepte les signes religieux dès lors qu'ils ne sont accompagnés d'aucun prosélytisme. Petit à petit, des laissés pour compte plongent dans l'intégrisme, soutiennent les «maquis» en Algérie. L'enquête sur les attentats de 1995 révèle l'apparition stupéfiante, parmi les poseurs de bombe, de Khaled Kelkal, 25 ans, petit délinquant de Vaulx-en-Velin, converti à l'islam en prison. En battant le Brésil en finale de la coupe du monde de football, le 12 juillet 1998, l'équipe de France «black-blanc-beur» déclenche un torrent de commentaires triomphalistes sur «l'intégration qui réussit». Trois ans plus tard, le symbole vole en éclat : le 6 octobre 2001, la Marseillaise est sifflée au Stade de France lors de France-Algérie. En 2003, les filles de banlieues de «Ni Putes, ni Soumises» organisent une marche en France, puis l'éclosion, en 2005, du mouvement des Indigènes de la République témoigne que certains ne se sentent pas Français. La loi sur la laïcité qui a interdit le port de foulard à l'école a suscité une incompréhension dans les cités et... quelques vocations de jeunes musulmanes pour se couvrir du hijab. Ainsi, Khadija El-Hakim, habitante d'une petite cité de Paris et soeur ainée de deux frères partis faire le Jihad en Irak (Redouane a été tué au combat à 19 ans) a démissionné de son travail pour porter le voile et sent les siens, arabes, rejetés : «En France, on nous a appellés les beurs, puis les clandestins, les étrangers, les musulmans et maintenant les islamistes, les terroristes.»
Un ministre pour représenter les banlieues
21 décembre 1990 : les banlieues siègent pour la première fois, et très officiellement, en conseil des ministres. Ces cités, où des violences, saccages, pillages et feux de voitures, viennent encore d'éclater après la mort, en octobre, dans un affrontement avec la police, d'un jeune habitant de Vaulx-en-Velin, ont désormais leur représentant à Paris. Et ce n'est pas n'importe qui : un poids lourd du parti socialiste, Michel Delebarre, qui de plus a rang de ministre d'Etat.
La politique de la Ville, jusqu'alors représentée discrètement par le délégué à la Ville, Yves Dauge, est intronisée en grandes pompes. Les 5, 6, 7 et 8 décembre 1990, à Bron, ville voisine de Vaulx et des Minguettes, les DSQ (Développement social des quartiers) sortent de l'ombre.
C'est la fin des bonnes intentions : on passe à l'action. Mitterrand annonce, dans son «discours de Bron» qu'il se donne cinq ans pour «réussir la politique de la ville». Le Président ne lésine pas sur les grands mots en lançant la création du ministère de la Ville. L'élu devra être «l'animateur, le pourfendeur, l'avocat, l'intervenant permanent qui attirera l'attention (de ceux) qui ne demandent pas mieux de réussir cette grande aventure mais qui pensent à autre chose, qui ont d'autres soucis, d'autrees compétences».
Suit un séminaire gouvernemental, où s'organise un plan de bataille tous azimuts sous l'égide de Michel Rocard, Premier ministre : il y aura 20 mesures pour «changer la ville» dans «quatre cents quartiers». Cette large géographie elle a presque doublé aujourd'hui- dilue le caractère d'urgence et d'exception que préconisait jusqu'alors la politique de la ville dans quelque 150 cités. Mais, à l'époque, les maires en difficulté avec leurs grands ensembles de HLM, rêvaient de la puissante main de l'Etat, et des finances qui bien sûr ne sauraient tarder. Quand Michel Delebarre prend ses fonctions, en 1991, il nomme 13 «sous-préfets à la ville», vigiles en avant-poste dans toutes les préfectures chaudes. L'ancienne Délégation à la ville lui sert d'administration. Quoiqu'étoffée, elle demeure toute petite (une poignée de fonctionnaires). Qu'importe. L'élan était donné, et il venait de haut. Les autres ministres (Logement, Education, Sport, etc) n'avaient qu'à suivre. Six mois plus tard, mai 1991, le Val-Fourré explose après la mort d'un jeune homme asthmatique au commissariat, celle d'une gardienne de la paix renversée par une voiture volée et d'un jeune tué par une balle policière.
Le 20 mai 1992, Bernard Tapie succède à Delebarre. Le nouveau ministre de la Ville, qui n'est plus «d'Etat», a à peine le temps de présenter son «plan pour les banlieues», qu'il démissionne le 23, poursuivi par les affaires.
Le poste ne va cesser de péricliter. Quand le gouvernement Jospin arrive aux affaires, en 1997, il ne comporte même pas de ministre de la Ville. Claude Bartelone arrivera bien plus tard. Mais en privilégiant toujours le bâti et non les habitants. Depuis 2002, Borloo en a fait son dossier principal. Avec le succès que l'on mesure aujourd'hui.
par Tonino SERAFINI, Patricia TOURANCHEAU et Brigitte VITAL-DURAND
mardi 08 novembre 2005
Dans les années 1960-1973, le béton coule à flots dans la périphérie des grandes villes. On construit jusqu'à 600 000 logements par an. Les grues sont partout pour juguler la crise du logement, pour résorber les bidonvilles comme à Nanterre ou à Villeurbanne, ou voit le jour le ministre Azouz Bégag. On bâtit aussi pour loger les rapatriés d'Algérie et les travailleurs des bassins industriels qui font appel à une main d'oeuvre étrangère abondante. C'est ainsi que naît le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie où «7 000 logements sont créés de toutes pièces sur le terrain d'un ancien aérodrome», rappelle Pierre Bédier l'ex-maire (UMP). Pour mener ses programmes, l'Etat créé des ZUP (Zone d'urbanisation prioritaire) souvent dénuées de commerces ou de services publics, vite rebaptisées «cité dortoirs». La plupart d'entre elles deviendront au fil des années des ZUS (Zones urbaines sensibles), objet de la politique de la ville. Traduction aujourd'hui, 717 quartiers représentant 4,5 millions d'habitants et une addition de difficultés : chômage de masse de 20 à 30 %, spécialement parmi les jeunes, familles aux revenus précaires, échec scolaire, déliquance... Tous les voyants sont au rouge. Le tout donnant aux habitants de ces quartiers le sentiment d'être victimes de discriminations et d'injustices.
A l'origine : le premier choc pétrolier et la progression du chômage frapperont en premier lieu ces quartiers, habités souvent par des salariés non-qualifiés sacrifiés sur l'autel des restructurations industrielles. Les parents perdent leur statut et leur enfants leurs repères. Face à cette réalité, la politique de la Ville consistera en une série d'atermoiements. On met d'abord le cap sur le bâti et la réhabilitation des immeubles. Dès 1977, Jacques Barrot, secrétaire d'Etat au Logement du gouvernement Barre, lance un Plan banlieue avec de conventions Habitat et vie sociale qui financent des programmes de rénovation de HLM. Ce traitement de problèmes humains par l'urbain est manifestement très ancré dans les esprits, puisque la loi Borloo d'août 2003, dotée pourtant d'un budget de 30 milliards d'euros sur cinq ans, est totalement centrée sur la question des tours et des barres qu'il faut faire tomber à coup de bulldozer. «Donner un meilleur cadre de vie aux gens, personne ne contestera ça. Mais on ne règle en rien les problèmes de fond des familles, c'est à dire l'emploi, l'insertion, et les questions éducatives», critique une responsable associative de Seine-Saint-Denis, département particulièrement touché par la flambée de ces derniers jours.
Une flambée qui en rappelle d'autres. Cela a commence il y a presque un quart de siècle, en juillet 1981. C'est «l'été chaud» dans la banlieue lyonnaise. Dans la cité des Minguettes, à Vénissieux, des jeunes se livrent à des rodéo et brûlent 250 voitures. L'Etat a sa réponse. Achevées dix sept ans plus tôt (en 1966), les Minguettes vont subir un premier traîtement de choc. Trois tours sont dynamitées en 1983, dont une en présence du président Mitterrand. A l'époque, on considère que la France compte 22 quartiers à «problème». Mais dans les mois suivant, la liste va très vite grossir pour atteindre les 148. Et comme les jeunes sont le fer de lance de la révolte, on ajoute à l'urbain une couche de politique éducative. En 1981, Alain Savary, ministre de l'Education, annonce la création de Zones d'éducation prioritaires (ZEP). Le dispositif est prévu pour durer quatre ans et concerne 363 ZEP. Vingt-quatre ans plus tard, 911 ZEP scolarisent 20 % des élèves. Dernier pilier : la sécurité. Mais là, au grès des ministres successifs, on passera du plan de prévention de la délinquance concocté en 1982 par Gilbert Bonnemaison, député-maire PS d'Epinay-sur-Seine, (avec 64 axes, contrats d'action dans les quartiers) aux politiques axés sur la répression de Pasqua (1986-1988) ou de Sarkozy.
En juillet 1991, Delebarre (lire ci-contre) fait voter la loi d'orientation pour la ville (LOV), qui oblige les communes ayant peu de HLM sur leur territoire à en construire, afin de mieux répartir les logement sociaux et d'éviter la constitution de ghettos. Une loi qui sera vidée de sa subtance par la gouvernement Balladur. Celui de Juppé a sa réponse, libérale : il crée 41 Zones franches urbaines (ZFU) pour inciter les entreprises à s'installer dans des ZUS (exonération d'impôt sur les bénéfices, sur les charges sociales). 700 quartiers sont classés ZUS. Un plan de «100 000 emplois-ville» destinés aux 18-25 ans est annoncé. Aucun bilan ne suivra.
Les soubresauts de la politique d'intégration
La gauche crée en 1983 le Conseil national de prévention de la délinquance (CNDP), puis décline la structure dans les départements, dans les villes. Mais ça ne suffit pas. Dans les quartiers, fils d'Algériens et de Marocains sont victimes de racisme. Le 13 juillet 1983, à la Courneuve, un habitant excédé tue un enfant de 9 ans, Toufik, tiré comme un pigeon. A l'automne, une quinzaine de jeunes des Minguettes acteurs de l'été chaud de 1981 organisent la Marche des Beurs et scandent «La France, c'est comme une mobylette, pour avancer, faut du mélange !». La manifestation «pour l'égalité et contre le racisme» rassemble 100 000 «black-blanc-beur» à Paris, où le Président reçoit les leaders, accorde à tous une carte de séjour et de travail valable dix ans. Ce mouvement spontané de la jeunesse arabe représente un espoir formidable. En octobre 1984 est lancé SOS Racisme, avec le slogan «Touche pas à mon pote». «Mais ces deux références n'ont jamais vraiment gravi les marches du pouvoir : la gauche a raté une occasion incroyable, dit René Rousseau de la CFDT inter-co (logement, pompiers, policiers, AS, etc). Les banlieues ont été traitées comme du social, jamais de manière politique. On a mis les immigrés à l'écart, et on les y a laissés. Les hommes politiques se sont repassés le grisby des banlieues comme une patate chaude.» L'arrivée de Charles Pasqua à l'Intérieur en 1986, dans un contexte d'attentats chez Tati, avec la répression des manifestations étudiantes contre la loi Devaquet mort de Malik Oussekine suscitent un climat de tension dans les banlieues. C'est la fin de la prévention. Les «marcheurs» pour l'égalité qui ont y cru finissent «dégoutés par les politique, écoeurés» selon Yazid Kherfi (lire page 10). Les «grands frères» baissent les bras. En 1989, de jeunes musulmans reprennent en main petits toxicos et voleurs, montent des salles de prières, parfois dans des caves. A Vénissieux, Toumi Djaïdja, le héros de la «marche des Beurs» a fait le «retour» à l'islam, tient un atelier de couture, a coupé ses boucles brunes, laissé poussé sa barbe : «Je mène le même combat, j'ai simplement changé d'étendard.»
A Creil, éclate la première affaire du voile islamique : trois jeunes musulmanes sont exclues de leur collège pour avoir refusé de retirer leur foulard en classe. Jospin, alors ministre de l'Education, temporise : l'école accepte les signes religieux dès lors qu'ils ne sont accompagnés d'aucun prosélytisme. Petit à petit, des laissés pour compte plongent dans l'intégrisme, soutiennent les «maquis» en Algérie. L'enquête sur les attentats de 1995 révèle l'apparition stupéfiante, parmi les poseurs de bombe, de Khaled Kelkal, 25 ans, petit délinquant de Vaulx-en-Velin, converti à l'islam en prison. En battant le Brésil en finale de la coupe du monde de football, le 12 juillet 1998, l'équipe de France «black-blanc-beur» déclenche un torrent de commentaires triomphalistes sur «l'intégration qui réussit». Trois ans plus tard, le symbole vole en éclat : le 6 octobre 2001, la Marseillaise est sifflée au Stade de France lors de France-Algérie. En 2003, les filles de banlieues de «Ni Putes, ni Soumises» organisent une marche en France, puis l'éclosion, en 2005, du mouvement des Indigènes de la République témoigne que certains ne se sentent pas Français. La loi sur la laïcité qui a interdit le port de foulard à l'école a suscité une incompréhension dans les cités et... quelques vocations de jeunes musulmanes pour se couvrir du hijab. Ainsi, Khadija El-Hakim, habitante d'une petite cité de Paris et soeur ainée de deux frères partis faire le Jihad en Irak (Redouane a été tué au combat à 19 ans) a démissionné de son travail pour porter le voile et sent les siens, arabes, rejetés : «En France, on nous a appellés les beurs, puis les clandestins, les étrangers, les musulmans et maintenant les islamistes, les terroristes.»
Un ministre pour représenter les banlieues
21 décembre 1990 : les banlieues siègent pour la première fois, et très officiellement, en conseil des ministres. Ces cités, où des violences, saccages, pillages et feux de voitures, viennent encore d'éclater après la mort, en octobre, dans un affrontement avec la police, d'un jeune habitant de Vaulx-en-Velin, ont désormais leur représentant à Paris. Et ce n'est pas n'importe qui : un poids lourd du parti socialiste, Michel Delebarre, qui de plus a rang de ministre d'Etat.
La politique de la Ville, jusqu'alors représentée discrètement par le délégué à la Ville, Yves Dauge, est intronisée en grandes pompes. Les 5, 6, 7 et 8 décembre 1990, à Bron, ville voisine de Vaulx et des Minguettes, les DSQ (Développement social des quartiers) sortent de l'ombre.
C'est la fin des bonnes intentions : on passe à l'action. Mitterrand annonce, dans son «discours de Bron» qu'il se donne cinq ans pour «réussir la politique de la ville». Le Président ne lésine pas sur les grands mots en lançant la création du ministère de la Ville. L'élu devra être «l'animateur, le pourfendeur, l'avocat, l'intervenant permanent qui attirera l'attention (de ceux) qui ne demandent pas mieux de réussir cette grande aventure mais qui pensent à autre chose, qui ont d'autres soucis, d'autrees compétences».
Suit un séminaire gouvernemental, où s'organise un plan de bataille tous azimuts sous l'égide de Michel Rocard, Premier ministre : il y aura 20 mesures pour «changer la ville» dans «quatre cents quartiers». Cette large géographie elle a presque doublé aujourd'hui- dilue le caractère d'urgence et d'exception que préconisait jusqu'alors la politique de la ville dans quelque 150 cités. Mais, à l'époque, les maires en difficulté avec leurs grands ensembles de HLM, rêvaient de la puissante main de l'Etat, et des finances qui bien sûr ne sauraient tarder. Quand Michel Delebarre prend ses fonctions, en 1991, il nomme 13 «sous-préfets à la ville», vigiles en avant-poste dans toutes les préfectures chaudes. L'ancienne Délégation à la ville lui sert d'administration. Quoiqu'étoffée, elle demeure toute petite (une poignée de fonctionnaires). Qu'importe. L'élan était donné, et il venait de haut. Les autres ministres (Logement, Education, Sport, etc) n'avaient qu'à suivre. Six mois plus tard, mai 1991, le Val-Fourré explose après la mort d'un jeune homme asthmatique au commissariat, celle d'une gardienne de la paix renversée par une voiture volée et d'un jeune tué par une balle policière.
Le 20 mai 1992, Bernard Tapie succède à Delebarre. Le nouveau ministre de la Ville, qui n'est plus «d'Etat», a à peine le temps de présenter son «plan pour les banlieues», qu'il démissionne le 23, poursuivi par les affaires.
Le poste ne va cesser de péricliter. Quand le gouvernement Jospin arrive aux affaires, en 1997, il ne comporte même pas de ministre de la Ville. Claude Bartelone arrivera bien plus tard. Mais en privilégiant toujours le bâti et non les habitants. Depuis 2002, Borloo en a fait son dossier principal. Avec le succès que l'on mesure aujourd'hui.
par Tonino SERAFINI, Patricia TOURANCHEAU et Brigitte VITAL-DURAND
mardi 08 novembre 2005