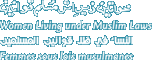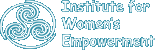Algérie: Rencontre avec écrivaine Maïssa Bey
Il ne s’agit, à proprement parler, ni de motivation ni même de préméditation. Ce n’est pas non plus l’aboutissement d’une vocation clairement identifiée. Bien au contraire, j’ai longtemps, peut-être trop longtemps, réprimé ou tenu à l’écart cette envie « d’intervenir », de jouer ma partition. Je ne saurais dire exactement les raisons qui m’ont poussée à franchir le pas. A tenter de rejoindre la cohorte de ceux qui ont façonné ma vie, je veux parler des hommes et des femmes entrés en écriture. J’en vois seulement une, essentielle. En franchissant le seuil pour entrer dans « le cercle des parlants », j’ai voulu échapper à cette malédiction qui pesait de tout son poids sur ma vie et celle de mes semblables, malédiction ainsi formulée, depuis des siècles : tu ne seras jamais toi-même. Toutefois, il n’est pas anodin de remarquer que j’ai commencé à publier précisément dans les années où l’on voulait faire taire les voix de tous ceux qui dénonçaient l’irrésistible avancée – si j’ose dire – d’une régression que certains qualifiaient de féconde [allusion au réconciliateur avec le FIS, l'universitaire algérien, enseignant depuis quelques années à Lyon, Lahouari Addi]. Il se trouve que jusqu’alors, je n’écrivais que pour expulser mes révoltes, mes colères, les mettre en mots afin de garder trace de toutes les histoires qui m’étaient racontées ou dans lesquelles je jouais un rôle. En fait, pour me regarder dans la page. Je n’envisageais pas, mais alors pas du tout, de pouvoir donner à lire à quiconque ce que j’écrivais. Et puis un jour, la fiction a pris le pas sur la réalité dans l’histoire que j’étais en train d’écrire. Passer de la réalité à la fiction m’a donné l’impression que je pouvais enfin aller beaucoup plus loin, que les portes s’ouvraient devant moi, une à une, et j’ai touché du doigt (ou de la plume) le bonheur et la précarité qui accompagnent tout acte de création, fait de moments de toute puissance et de douleur inextricablement liés. Et depuis, je continue, avec pour principal moteur, le sentiment d’être enfin, sur le territoire de l’écriture, totalement libre, de pouvoir aller jusqu’au bout de moi-même et par-dessus tout un désir de plus en plus grand de partage.
Peut-on alors parler de volonté de s’inscrire dans le temps par le biais de l’écriture?
Une des motivations premières, pour beaucoup, serait un désir, avoué ou non, de reconnaissance, de perpétuation de la mémoire d’une vie. Ecrire, créer, seraient des actes contre l’oubli, contre le caractère éminemment éphémère de notre passage sur terre. Mais il y a eu d’abord pour moi l’écriture des autres. Les textes que je lisais, avec avidité, avec passion, je me les appropriais. Ils m’ont aidée à vivre et je dirais même que j’ai écrit des moments de ma vie grâce à eux. Ils m’ont nourrie. L’écriture des autres n’a pas seulement agi comme révélateur, mais aussi et surtout comme une présence indispensable qui éclairait à tout instant ma vie, mes choix, mes passions et m’aidait à comprendre – ou à fabriquer? – mes révoltes. Si, aujourd’hui, je suis attentive aux autres, à moi-même, c’est parce que ce sont les livres qui ont fondé ma connaissance des autres et qui ont fait de moi ce que je suis. Il m’a fallu du temps, beaucoup de temps, pour m’enhardir, pour oser à mon tour passer de l’autre côté du miroir, de l’autre côté de la page. Pour entendre et vouloir faire entendre tous les mots qui bruissaient en moi au cœur des silences imposés. Pour me résoudre enfin à prendre la parole comme d’autres prennent les armes. Avec la même appréhension, mais aussi la même détermination. Avec, enfin, les seuls outils dont je disposais: les mots.
Quel est votre sentiment par rapport à l’affirmation selon laquelle vous représentez « le nouveau roman féminin » dans la littérature algérienne?
Ce serait présomptueux de ma part et somme toute périlleux, parce je pourrais me croire investie d’une mission et me prendre au sérieux. Et dans ce cas, bonjour les dommages ! On connaît bien les ravages que peuvent faire tous ceux qui se croient investis d’une mission ! Je peux tout simplement dire que je m’inscris, avec d’autres, de plus en plus visibles, de plus en plus audibles, dans une génération d’écrivaines qui ont en commun une volonté, celle de prendre publiquement la parole pour dire et tenter de faire entendre de multiples voix souvent inaudibles. Et elles sont de plus en plus nombreuses à tenter de se frayer un chemin dans un espace que beaucoup considéraient jusqu’alors comme chasse gardée. Le problème est de savoir – ou pouvoir – rester authentique, de ne pas renoncer à sa vérité, celle qui est inscrite dans les replis les plus secrets de son être.
Vous avez d’abord publié des nouvelles. Le pas vers le roman a-t-il été périlleux?
J’aime les textes en fragments, tout comme j’aime le mouvement fluide de la narration. Dans mon écriture, comme dans la vie, il y a des halètements, des brisures, des ruptures dont certaines sont parfois inattendues, pas « classiques » pourrait-on dire. C’est aussi une autre forme de fragmentation. Mais, contrairement à ce que l’on pense couramment, l’écriture de nouvelles est un exercice très périlleux. Si la nouvelle est un récit bref, resserré, où la tension dramatique demande une rigueur et une précision délicates, le roman offre, par contraste, la possibilité d’explorer un espace plus vaste et l’on peut sans cesse en repousser les frontières. Bleu Blanc Vert a été en ce sens une expérience très intéressante.
Comment définissez-vous l’écriture féminine? Quelles sont les marques, l’empreinte de celle-ci?
Quand on vit dans une société bardée d’interdits qui oblige à faire des concessions aux uns, aux autres, à l’autre, l’écriture féminine est souvent perçue comme un acte délibéré de transgression, même si ce que l’on écrit n’est pas délibérément subversif. Cependant, je suis sûre qu’aujourd’hui, les femmes qui écrivent n’écrivent plus dans une perspective de confrontation ou de transgression. Nous n’en sommes plus là! Il y a d’abord, et essentiellement, l’acte créateur qui se fait au nom d’un désir qui est le même que celui de leurs homologues masculins: celui de prendre la parole, publiquement, et surtout d’assumer cette prise de parole comme un acte de liberté. Et de fait, on ne peut concevoir l’écriture que comme le souffle de la liberté, un dépassement de soi et de ses conditions d’existence. Mais ce n’est pas un objectif en soi. Je pense que pour bien des femmes, ce besoin est encore bien plus primordial. C’est par l’écriture qu’elles peuvent lever la chape du déni qui pèse sur l’individu – mais plus encore sur les femmes – en tant qu’être autonome, symboliquement séparé de son groupe. Ecrire permet d’arracher le droit d’être, simplement d’être. C’est dans ce sens – et pour pasticher une formule célèbre – qu’il m’est souvent arrivé de proférer cette sentence: « J’écris, donc je suis »!
Etes-vous féministe?
Si dire ce qui est, donner aux femmes la possibilité de se reconnaître dans les personnages que je crée, de se poser des questions et de mettre des mots sur leur désir d’être entendues, reconnues, c’est être féministe, alors oui, je suis féministe. Je peux simplement affirmer que mon écriture est née du désir de redevenir sujet, de remettre en cause, frontalement, toutes les visions d’un monde fait par et pour les hommes, de découvrir et éclairer autrement ce que l’on croyait connaître. J’ai envie de dire les exils quotidiens, insidieux, destructeurs vécus par les femmes. Je veux les sortir des réserves dans lesquelles l’imaginaire masculin en mal d’exotisme ou de nostalgie les a parquées, des harems, des gynécées et autres lieux domestiques pleins de mystères.
Le « je » est souvent présent en écriture féminine. Pourquoi ce procédé d’écriture est-il si utilisé par les romancières, d’après votre expérience en écriture?
Ce n’est pas une spécificité de l’écriture féminine que de se glisser dans la peau d’un personnage, qu’il soit masculin ou féminin. Les exemples abondent en littérature. Le reste est une question de choix d’écriture. Et parfois, du moins dans mon cas, cela se fait pour des raisons de stratégie d’écriture. Dire « je » est une façon de se couler dans le plus intime de l’être et par-là même d’aller au plus profond. Certes, il est parfois difficile de se dissocier des personnages que l’on crée, mais je ne pense pas que seules les écrivaines ressentent cette difficulté.
Vous vivez loin de la capitale, loin du brouhaha de la grande ville et aussi loin des réseaux d’édition…
Je vis à Sidi Bel Abbès depuis plusieurs années. Mais je suis souvent à Alger où j’ai beaucoup d’attaches. Malgré l’éloignement, même au plus fort des années de plomb, je n’ai jamais cessé de me tenir au courant de l’actualité culturelle, en particulier tout ce qui concerne la production littéraire algérienne. Sur les rayonnages de ma bibliothèque, figure un très grand nombre de romans édités en Algérie, achetés dès leur parution dans l’unique librairie digne de ce nom à Sidi Bel Abbès. J’ai toutefois souvent ressenti comme un véritable manque l’absence totale de contact et de rencontres littéraires comme il s’en passe à Alger qui est, de ce point de vue et sans conteste, la capitale culturelle.
Dans votre dernier et superbe roman 'Bleu Blanc Vert', on retrouve des détails saisissants de la mémoire d’Alger, comme le passage des acteurs Anna Karina et Marcello Mastroianni dans cette ville. L’avez-vous vécu vous-même?
Comment aurais-je pu raconter ces années sans les avoir vécues moi-même? J’ai voulu retracer le parcours de toute une génération qui a eu l’immense privilège (on l’oublie souvent !) de vivre des moments « historiques ». Depuis les fêtes de l’indépendance et l’euphorie qui a littéralement porté pendant plus d’une décennie tout un peuple trop longtemps asservi, jusqu’à ce que j’appelle la grande désillusion dont nous n’avons pas vraiment mesuré les points d’impact. Ce roman a été écrit en réponse à une question que nous nous sommes posé en 2002, lors de la célébration des quarante années d’indépendance. Cette question est la suivante: Qu’avons-nous fait de nos quarante ans? Et c’est dans ce « nous » que j’ai voulu inscrire l’histoire des deux personnages principaux. Je pense aussi que si vous vous y êtes reconnu, comme bon nombre de lecteurs, c’est que vous avez vous-même partagé ces moments et que vous avez eu l’impression d’entrer dans une histoire qui aurait pu être la vôtre.
Dans ce roman, vous cassez les tabous aussi bien politiques, sociaux que sexuels, à travers une fresque du temps qui passe. Quelle est l’importance de la mémoire dans l’histoire d’un peuple pour vous?
C’est peut-être une fresque, au sens pictural du terme, avec des tableaux en petites touches, un mélange de fiction et de souvenirs personnels. J’ai écrit ce livre avec le désir de revenir sur les chemins de mon enfance et plus loin encore. Revisiter le passé pour éclairer ou tenter d’éclairer le présent. Avec la difficulté inhérente à un tel projet et qui m’a accompagnée tout au long de l’écriture de mon texte: je devais prendre garde en rédigeant cette chronique de ne pas adopter la posture de celle qui sait. Qui sait ce qui va advenir, ce que les événements relatés portent en eux? Il m’a fallu évacuer toutes les tentations d’explication des faits pour en extraire seulement l’immédiateté et non la portée mortifère. Il s’agit donc d’un travail de remémoration au sens premier de restitution par la mémoire de faits passés. Quand à la mémoire collective, je pense qu’il faut s’en défier parce qu’il y a souvent occultation, plus ou moins consciente, plus ou moins instrumentalisée par l’histoire telle que revisitée par les commémorations qui prennent trop souvent le pas sur la remémoration justement.
Justement, lorsque vous écrivez, partez-vous du réel? Ou bien, avez-vous une idée d’histoire à raconter qui vous mène ensuite vers une recherche sur le sujet?
Souvent, très souvent, je ne choisis pas mon sujet. Il s’impose à moi. A partir d’une réflexion, d’un fait divers ou d’une histoire entendue au hasard d’une rencontre, d’une conversation. Il y a ensuite une période (parfois très longue) de maturation. Tout ce que je lis, tout ce que je vois, tout prend alors sens et alimente ce travail de maturation. Pour 'Bleu Blanc Vert', c’est en centrant le récit sur un lieu unique, l’immeuble – qui, à mon sens, est le personnage principal de cette chronique – que j’ai réussi à revenir sur les traces de notre histoire. C’est dans cet immeuble – situé à Alger, plus précisément au Ruisseau, et dans lequel j’ai passé les moments les plus importants de ma vie, enfance et adolescence, moments où l’on se construit et s’affirme – que se déroule toute l’histoire. Bien entendu, il m’a fallu faire des recherches pour ne pas trahir le réel, du moins sur le plan de la chronologie des faits historiques évoqués.
Est-ce que vous vous percevez comme une « porte-parole » des femmes?
Mon premier mouvement serait de rejeter catégoriquement ce que l’on pourrait considérer comme un titre. C’est la connotation de ce mot, dans ce qu’il a d’officiel et de convenu, qui me fait réagir ainsi. De quel droit m’arrogerais-je ce titre? Pourtant, en allant au plus près du mot lui-même, et en évacuant toute référence à une quelconque distinction, cette proposition pourrait m’agréer : porter la parole des femmes, la rendre, comme je le disais tout à l’heure, audible, trouver les mots pour leur donner l’occasion d’affirmer leur présence au sein d’une société qui trop souvent les relègue au rang de procréatrices. Oui, en ce sens je peux accepter de me mettre au service de cette « représentation ».
Avez-vous une perception positive de la littérature, dans le sens du rôle que peut jouer cette dernière sur le politique?
L’écriture est une façon pour moi de rendre compte de la société, de ses dérives et des cheminements souvent douloureux d’hommes mais surtout de femmes anonymes à travers l’histoire tourmentée de ce pays. Si l’on considère que tout roman est le lieu où se croisent réel et fiction, où, nécessairement, ils s’entretissent, le lieu ou les manques et les insuffisances du réel sont comblés par des fragments de fiction, on pourrait croire qu’il peut agir sur l’inconscient collectif. Cependant, on ne peut pas ignorer que la place de la littérature (et de la culture de façon générale) et donc sa portée, est encore trop restreinte, pour ne pas dire minime dans un espace où les forces qui s’affrontent semblent – ou veulent – ignorer que toute œuvre littéraire ou artistique fait nécessairement écho au désarroi et aux inquiétudes d’une société face au déni de ses aspirations et à la négation de toutes les facettes de sa mémoire.
Votre production littéraire est clairement située dans la période postcoloniale. D’après vous, peut-on sortir du postcolonial en tant que marqueur historique?
Beaucoup considèrent que la production littéraire postcoloniale répond à un besoin unique: la quête identitaire. Vaste sujet sur lequel les spécialistes de la question ne cessent d’axer leurs recherches. Toutes les thèses écrites sur ce thème regorgent d’arguments que je saurais développer. La lecture de ces textes a été fortement influencée par des approches socio-culturelles et socio-psychologiques variées qui ont toutes comme référent ce marqueur historique et l’on s’attelle à définir « l’espace culturel et psychique maghrébin » pour analyser et éclairer les ressorts de cette littérature. Sans rejeter toutes ces théories qui ont le mérite de vouloir rendre compte des relations complexes qu’un auteur entretient avec la langue, l’histoire et l’identité, je dois pourtant dire que s’interroger sur son identité, sur son histoire, sur sa terre natale, sur son rapport à l’Autre et à l’ailleurs est légitime. C’est aussi et surtout une démarche universelle. Une quête sans fin. Je préfère tout simplement penser la littérature comme un point de convergence où se retrouveraient et se reconnaîtraient tous ceux qui tentent de rejoindre l’humain en l’homme.
Comment percevez-vous l’Algérie en termes d’égalité entre femmes et hommes? Est-ce que l’on va vers le bon sens?
C’est une question qu’on me pose souvent à l’étranger. Sous une autre forme: comment percevez-vous la condition de la femme en Algérie? Sous-entendu dans un pays d’Islam, dans un pays où, contrairement aux autres pays du Maghreb, les lois qui régissent le statut de la femme sont si rétrogrades qu’elles restreignent considérablement son champ d’action. Que répondre? Tout simplement qu’il y a des hommes et des femmes conscients des dysfonctionnements d’une société où le paradoxe est érigé en principe, un principe vécu et accepté. Des hommes et des femmes qui se battent inlassablement contre toutes les formes de régression, même les plus insidieuses, et que, par conséquent, on ne saurait partir de ces postulats pour rendre compte d’une situation trop complexe pour qu’on puisse formuler des hypothèses sur le devenir – programmé ou non – de cette société.
Lisez-vous les autres romancières algériennes. Laquelle vous inspire le plus?
Je vous disais que je lisais tout ou presque, avec, naturellement, non pas une préférence, mais une attention particulière pour les paroles de femmes. Si je devais citer un auteur, un seul, ce serait bien évidemment Assia Djebar que j’ai lue, très jeune, avec le sentiment incroyable que, sous mes yeux, s’écroulaient les représentations et s’effondraient peu à peu des barrières que je croyais solidement ancrées. Pas seulement parce qu’elle avait pris la parole et mis en scène, avant l’Indépendance, des personnages féminins qui, engagées aux côtés des hommes dans un combat pour la libération de leur terre, une guerre anticoloniale, avaient en même temps engagé un autre combat, celui de leur propre libération. La lecture de ses romans a été pour moi une véritable révélation. C’était une femme, une femme qui osait transgresser la norme, à savoir le confinement de la parole féminine dans l’espace privé. Une femme qui osait dire le corps, dire les sensations les plus intimes des femmes, qui créait… Cela me semblait tellement courageux que j’ai vraiment eu l’impression qu’en pionnière, elle ouvrait un chemin sur lequel bien d’autres depuis se sont engagées.
Par: Benaouda Lebdaï
6 septembre 2007