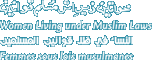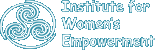Algérie: Aldjia Noureddine Benallegue: première femme médecin algérienne
--Flaubert
Elle a obtenu son doctorat en janvier 1946 et est devenue membre fondateur de la Société algérienne de pédiatrie en novembre 1947. Elle a été élue en 1982 membre de l’Académie nationale de médecine de France. Elle a rehaussé le niveau de la médecine algérienne au sein de laquelle elle a mené, jusqu’à son admission à la retraite en 1989, une activité exigeante et rigoureuse de praticienne, de formatrice, d’animatrice. Cette battante qui a parcouru les quatre cinquièmes du XXe siècle est une femme généreuse, attachante. Elle possède une politesse du cœur rare dans un monde formatisé, robotisé, brutal. Son métier l’a sans doute préparée à cela. Elle porte sur les autres un regard attentif, tendre. Mélange d’orgueil et de modestie, elle raconte, avec un luxe de détails inouï, son enfance dans ses vieilles terres fières de Kabylie. Lorsqu’on a demandé à l’une de ses condisciples de la décrire en quelques mots, elle n’a pas hésité un instant. « Enjouée, truculente, chaleureuse, discrète, attentionnée et surtout les pieds sur terre. On ne peut la qualifier autrement. » Ainsi est fait l’itinéraire hors du commun de cette femme bon pied, bon œil qui va bientôt fêter ses 89 ans et qui respire une énergie de tout instant.
Un itinéraire hors du commun On l’a un peu froissée lorsque nous lui demandions quel personnage était son père ! Utiliser le terme personnage pour définir son paternel ? Quel impair ! Quelle offense ! Presque une insulte. « Ce mot est impropre à mon sens. Il ne convient pas. Mon père fut un Monsieur, un grand Monsieur distingué. Son aspect extérieur classique et son comportement plutôt discret dans la vie courante, son abord facile pour tous ceux qui venaient solliciter ses conseils éclairés et judicieux ou s’instruire dans une simple conversation, c’était sa nature propre, pas une façade », note-t-elle sur un ton ferme et décidé. Son père Amar Noureddine, qui a eu une influence certaine sur elle, est né en 1893 dans un petit village de Kabylie à Aït Halli. Il y vécut son enfance et son adolescence puis vint à Alger poursuivre ses études à l’Ecole Normale de Bouzaréah d’où il en sortit instituteur diplômé en 1912. C’était un érudit toujours respectueux de l’autre, un sage qui ne jugeait jamais à la légère. « Pour moi, ce fut un père exceptionnel, puisque, bravant les esprits bornés de l’époque, il m’a fait apprécier l’apprentissage scolaire comme il l’a fait pour mes frères, alors que tant d’autres n’instruisaient que leurs garçons, condamnant donc leurs filles à l’ignorance, donc à la faiblesse. Parallèlement, il me guidait en m’éclairant sur les données sociales. Pour lui, l’avenir de l’humanité n’était pas concevable sans la participation effective de la femme aux progrès de la société. » Dans le contexte de l’époque, à la fin des années 1920, agir de la sorte constituait une véritable gageure pour des indigènes tout juste bons à être asservis. Dans la Kabylie où elle grandit très librement dans le milieu familial, l’école lui a appris à bien se tenir en société. Elle garde des souvenirs vivaces aux côtés de son père, de sa mère et de ses trois frères. Cette période est celle où l’on s’imprègne, comme par osmose, non seulement du présent, mais aussi du passé raconté intentionnellement ou évoqué. « Notre mode de vie était des plus simples. A la maison, nous nous retrouvions tous réunis aux repas à la même table : la politesse, la ponctualité, le respect, la correction vestimentaire, la gestuelle, l’élocution, tout ce qui fait l’éducation de base, s’apprenait ainsi au fil des jours. » Pourtant, jeune enfant, elle a été contrariée. « Nous habitions Médéa. L’école communale refusa de m’inscrire parce que j’étais une indigène qui devait être scolarisée à l’école ouvroir. Pour mes parents, ce fut l’indignation. Pour moi, ce fut une aubaine et une joie. Aubaine parce que ma jeune tante maternelle qui fréquentait cette école depuis plusieurs années allait m’y accompagner, donc vivre avec moi, avec nous, comme une sœur aînée si gentille, si agréable. » Son passage au lycée fut tout aussi chaleureux. Une vie de pensionnaire au lycée de jeunes filles d’Alger, pendant sept ans, pour décrocher le bac en 1935. Aldjia conte avec délectation ses années heureuses. Elle sait choper au vol le détail cocasse et éloquent qui traque l’essentiel. Balayant les idées reçues, elle se montre intrépide face aux conservatismes. Manifestement, son destin était lié à celui de l’Algérie. « Je crois que cela allait de soi. Il suffisait de voir au lieu de regarder sans voir, d’écouter au lieu d’entendre sans comprendre. Il fallait vaincre les réticences de la société algérienne quant à la condition de la femme. En même temps, comment ne pas se révolter devant l’injustice et le mépris souverain que nous manifestait la colonisation dans tous les domaines. Il fallait progresser. Pour avancer. Rien ne nous est donné. Il fallait conquérir, et dignement, ce à quoi nous aspirions pour nous-mêmes et pour autrui. Le parcours était plein d’embûches, mais à cœur vaillant, rien d’impossible, c’est la devise que j’ai adoptée. » Lorsque nous lui demandons son sentiment sur ceux qui prônent aujourd’hui la colonisation positive, elle use d’une parabole sémantique. « Pour qui a subi la colonisation, ces deux mots accolés constituent une antinomie », se limite-t-elle à dire…
La médecine, une vocation Aldjia évoque son riche parcours à l’hôpital Parnet. Lorsque nous lui demandons si la médecine était pour elle une mission ou un métier, elle répond : « C’est une vocation, en partie innée, mais alimentée aussi par différents souvenirs. Ainsi, celui d’un grand oncle, frère de ma grand-mère maternelle, qui fut parmi les premiers étudiants algériens en médecine, fauché par la maladie au moment de cueillir ses lauriers. » Puis une impression très forte causée par l’ensemble des médecins consultés. « Leur présence rassurait nos parents angoissés et ils nous guérissaient avec un sirop, une potion ou des comprimés ! Une fois, au lycée, j’avais été subjuguée par la perspicacité du médecin qui savait distinguer une maladie « réelle » et la comédie jouée par ma camarade de chambre, tout cela était magique pour une enfant… » MmeAldjia et le système de santé algérien actuel ? Elle considère qu’elle a pris assez de recul, près de 20 ans, après sa retraite, pour pouvoir émettre un quelconque jugement. Quant au rôle de la femme algérienne, elle y croit fermement. « Mais, comme dans d’autres pays, il est vraisemblable qu’on ne lui fera pas de cadeaux. C’est par son mérite personnel et une solidarité fraternelle, par l’effort et la persévérance qu’elle s’imposera. »
Notre génération a fait de son mieux Elle sait de quoi elle parle puisqu’elle est l’une de celles qui ont défendu les femmes, qui ont traversé beaucoup de souffrances comme l’agressivité, la solitude, le doute… Son sentiment à l’égard de l’Algérie de 2008… Optimiste ? Pessimiste ? « Notre génération a fait de son mieux, je crois, pour aider à l’édification d’un peuple prospère, moderne. Si l’Histoire d’un peuple n’est jamais rectiligne, elle doit cependant tendre toujours vers la fraternité et le progrès. Les aléas de la vie et de ma résistance physique ont fait que depuis plusieurs années je suis très peu sortie de ma coquille. Pour répondre à votre question, en cette année 2007, il m’a été donné, à deux reprises, l’opportunité de sortir un peu et de circuler à pied dans une artère principale de la ville, une fois au printemps, l’autre plus récemment, en automne. Passons sur la cohue des véhicules. Ce qui m’a bouleversée, c’est la foule humaine : des personnes que je connaissais peu ou pas, m’arrêtant pour me dire avec un sourire bienveillant : « Ah, Madame, que c’est bon de vous revoir, vous êtes revenue ! » Comme si je représentais pour eux une époque heureuse, un passé révolu. Et puis, surtout, le spectacle insoutenable aux deux extrêmes de la ville : l’enfance déshéritée et les adultes ou vieillards usés avant l’heure, tous abandonnés à leur triste sort. Comment supporter les reproches muets des visages hâves, leur regard triste ou vide, désabusé, les traits tirés, les rides prématurées, les vêtements en piteux état ? Comment admettre le spectacle de tous ces jeunes adultes inactifs adossés à un mur, rêvant d’une perspective de travail quelque part hors de la patrie alors que d’immenses chantiers sont en cours mais sans eux ? Comment peut-on laisser ainsi se développer une classe de parias dans notre société ? On ne construit pas un barrage, un pipeline, une autoroute, avec des dons récoltés de ci de là, à travers le pays. De même, à cette échelle, ce ne sont pas des actions ponctuelles, du bénévolat ou des œuvres caritatives diverses qui peuvent remédier à cette situation, mais une politique nationale engageant l’Etat tout entier. Pour la survie du pays d’abord et pour avancer dans la fraternité vers le progrès ; aujourd’hui, c’est plus qu’une urgence, c’est un impératif. Les possibilités concrètes de développement harmonieux de notre pays sont réelles, elles sont aussi réelles en potentiel humain, aussi bien en valeur quantitative que qualitative. Il suffit de le vouloir pour le réaliser. C’est pourquoi, en cette fin d’année 2007, malgré ce qui m’a bouleversée, je reste optimiste, répétant comme une litanie : à cœur vaillant, rien d’impossible. » Dans son ouvrage paru récemment, elle a terminé par cette phrase pleine de sens. « S’il est vrai qu’on ne reconstruit jamais la passé, on doit cependant le visiter pour comprendre le présent… » On ne pouvait espérer mieux en guise de conclusion.
Aldjia est née le 28 juin 1919 en Kabylie, elle a obtenu son doctorat en médecine en janvier 1946. Elle est l’auteur d’un livre autobiographique paru récemment aux éditions Casbah dans lequel elle décortique sa vie. « De ces 80 années, la moitié s’est déroulée dans un pays colonisé, assujetti depuis 1830 par la France ; l’autre moitié dans un pays libéré de cette tutelle, indépendant depuis le 5 juillet 1962. » La colonisation, ce n’était pas une abstraction, c’était une hiérarchie du mépris qui a fonctionné dans tous les domaines. Formatrice, animatrice, toujours près des gens, Aldjia était très appréciée là où elle exerçait. Outre sa distinction à l’Académie de France, elle a eu l’honneur de présider plusieurs colloques d’envergure à travers le monde.
El Watan du 3 janvier 2008, p1
Par: Hamid Tahri